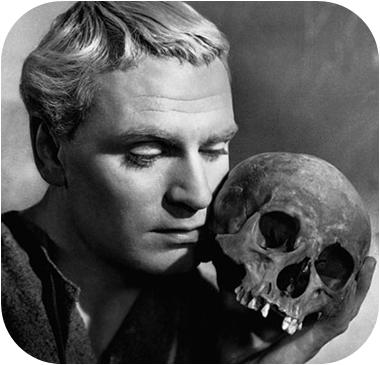L’impossible comme limite du réel
« Non possumus »[1]
« Non possumus », dit Louis XIV le 12 juin 1709, dénouant ainsi le moment le plus tragique de son règne. « Nous ne pouvons pas. »
En ce début d’année 1709, le vieux roi (il a soixante-dix ans) sait bien qu’il est aux abois, que son trône ne tient plus qu’à un fil fragile et qu’aucun de ses prédécesseurs depuis Charles VII n’a affronté une situation si désespérée. Il doit même se demander comment lui le Roi-Soleil devant qui l’Europe a tremblé peut connaître un si sombre crépuscule.
Après l’hallali, l’Europe programme une curée à la mesure de la grandeur passée de la France et de son roi insolent.
Tout commence par un heureux coup de théâtre et une décision audacieuse.
Le 1er novembre 1701, Charles II roi d’Espagne meurt sans héritier direct. Contre toute attente, il désigne dans son testament comme héritier le second petit-fils de Louis XIV et de sa sœur Marie-Thérèse, Philippe duc d’Anjou. Ce testament surprise, apparemment favorable à la France, place en réalité le pays du Roi-Soleil dans une situation délicate. Refuser le testament, c’est favoriser une succession autrichienne et voir se reconstituer l’empire de Charles Quint. Accepter le testament, c’est certes se donner la chance d’installer une monarchie alliée au-delà des Pyrénées, mais c’est à coup sûr déclencher une guerre européenne. Ni l’Angleterre, ni l’Autriche, ni les Provinces-Unies ne laisseront faire. Ces pays sont depuis un siècle trop inquiets de la puissance grandissante de la France à laquelle ils ont déjà fait plusieurs guerres. Ils considèrent la France comme le perturbateur de l’équilibre européen, ils ne peuvent donc accepter une augmentation de la puissance française sans prendre le risque de voir ce pays devenir à terme le maître de l’Europe.
Le mercredi 10 novembre 1701 à Fontainebleau, Louis XIV décide, après deux conseils des ministres particulièrement longs, indécis et tragiques, d’accepter le testament. La guerre de succession d’Espagne est lancée. Elle va durer douze ans et plonger la France dans autant d’extrêmes périls que de terribles épreuves.
Contrairement aux guerres précédentes menées par Louis XIV, cette guerre tourne plutôt mal. À l’automne 1708, la campagne de Flandre est un nouvel échec. L’état des troupes, des finances et du royaume contraint Louis XIV à demander une paix dont il sait qu’elle sera rigoureuse pour la France.
Dès les premiers contacts, les Hollandais font savoir qu’il faut rendre l’Espagne, les Indes, le Milanais, les Pays-Bas[2]. Le roi accepte ces clauses draconiennes comme préalable à l’ouverture des discussions. Le 5 mars 1709, le président Rouillé part pour La Haye muni de directives lui permettant de larges concessions.
C’est qu’au même moment, le royaume vit une épreuve supplémentaire. Depuis début janvier, la température est descendue à vingt degrés au-dessous de zéro. Le bétail meurt de froid, les hommes aussi. Il faut la paix, la paix à tout prix. Quand des centaines de milliers d’hommes meurent de faim, il n’est plus question de se battre.
À Rouillé, les coalisés présentent des requêtes qui paraissent inouïes. Il faut rendre la basse Alsace. L’Angleterre veut Dunkerque, le roi de Prusse veut Neuchâtel. Louis XIV devra rendre au duc de Savoie tous ses États. Surtout il faudra renoncer à la frontière septentrionale (la fameuse ceinture de fer dont Louis XIV est si fier), abandonner Ypres, Condé, Tournai, Maubeuge et surtout Lille. Toul et Verdun dédommageront le duc de Lorraine. Les protestants français retrouveront leur nationalité, leur liberté et leurs biens. La haine de la France s’exprime dans toute sa brutalité.
Bref, on demande à Louis XIV d’abandonner tout ce qu’il a conquis au cours de son règne et de renoncer à la décision dont il est le plus fier : la révocation de l’édit de Nantes. C’est le démontage systématique d’une œuvre séculaire qui est exigé.
Les Hollandais pensent sans doute que de telles exigences valent refus de paix. Comment Louis XIV pourrait-il accepter une pareille humiliation, un tel abaissement ? Comment pourrait-il abandonner son œuvre, celle de Mazarin et même celle de Richelieu ?
Le croira-t-on ? Le roi de France, ce fier monarque ex-arbitre de la chrétienté, toute honte bue, cède une fois de plus tant il a besoin de la paix. Contrairement à la légende, Louis XIV n’est pas un monarque orgueilleux. Il connaît et pratique depuis longtemps ce que l’on appelle aujourd’hui la Realpolitic à laquelle Mazarin l’a initié dans sa jeunesse. Ses ennemis sont en position de force et le savent. Louis XIV a sans doute trop régné pour s’étonner de leur dureté.
Mais en dépit de l’acceptation de Rouillé à toutes leurs exigences, les coalisés n’ont pas encore donné leur accord. Alors, contre toute tradition, Louis XIV envoie son ministre le marquis de Torcy à La Haye pour supplier les ennemis de signer cette paix. Humiliation ultime et peut-être superflue.
Du 6 au 28 mai 1709, Torcy est à La Haye. C’est « un vol de corbeaux », comme si la nation franque était déjà réduite à l’état de cadavre. Pour la partie anglaise, les négociations sont menées par Marlborough qui hait la nation française et ne lui fera aucun cadeau[3]. Fidèles à leur tactique, les coalisés présentent chaque jour une exigence nouvelle. Au bout de trois insupportables semaines, les coalisés ont finalement mis au point noir sur blanc les quarante articles dits « préliminaires de La Haye ». Louis XIV doit reconnaître l’archiduc d’Autriche comme roi d’Espagne. Le duc d’Anjou devenu roi d’Espagne sous le nom de Philippe V aura deux mois pour se retirer de la scène, faute de quoi les coalisés et le roi de France « prendraient de concert les mesures nécessaires ».
Cette fois-ci Torcy comprend que les coalisés, galvanisés par la faiblesse française, sont sans doute allés trop loin et ont dépassé les limites du concevable. Ainsi, si Philippe V refuse de se soumettre et de quitter de son plein gré le trône d’Espagne, ce qui est probable, son grand-père devra lui faire la guerre pour l’y contraindre. Et en effet, quand cette clause est connue en France, elle soulève l’indignation et Louis XIV qui ne manque pas de bon sens affirme qu’il préfère « faire la guerre à ses ennemis qu’à ses enfants ». Les coalisés ont commis une erreur tactique qui va leur coûter cher.
Louis XIV est allé au bout des humiliations. « Non possumus ». Nous ne pouvons pas. Le vieux roi va faire un acte politique inédit : prendre son peuple à témoin en lui écrivant une lettre qui sera lue dans toutes les paroisses. Manœuvre d’un grand politique qui a compris avant l’heure ce qu’était l’opinion publique et la force dormante que l’on pouvait éveiller dans le sein sacré de la nation rassemblée et unie.
Le 12 juin 1709, donc, Louis XIV écrit aux Français :
« L’espérance d’une paix prochaine était si généralement répandue dans mon royaume que je crois devoir à la fidélité que mes peuples m’ont témoignée pendant le cours de mon règne, la consolation de les informer des raisons qui empêchent encore qu’ils ne jouissent du repos que j’avais dessein de leur procurer. J’avais accepté, pour le rétablir, des conditions bien opposées à la sûreté de mes provinces frontières ; mais plus j’ai témoigné de facilité et d’envie de dissiper les ombrages que mes ennemis affectent de conserver de ma puissance et de mes desseins, plus ils ont multiplié leurs prétentions.
Je passe sous silence, les insinuations qu’ils m’ont faites de joindre mes forces à celles de la ligue, et de contraindre le roi mon petit-fils à descendre du trône, s’il ne consentait pas volontairement à vivre désormais sans États, et à se réduire à la condition de simple particulier. Il est contre l’humanité de croire qu’ils aient seulement eu la pensée de m’engager à former avec eux pareille alliance. Mais, quoique ma tendresse pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j’ai pour mes propres enfants ; quoique je partage tous les maux que la guerre fait souffrir à des sujets aussi fidèles, et que j’aie fait voir à toute l’Europe que je désirais sincèrement de les faire jouir de la paix, je suis persuadé qu’ils s’opposeraient eux-mêmes à la recevoir à des conditions également contraires à la justice et à l’honneur du nom français.
[…]
J’écris aux archevêques et aux évêques de mon royaume d’exciter encore la ferveur des prières dans leurs diocèses ; et je veux en même temps que mes peuples sachent qu’ils jouiraient de la paix, s’il eût dépendu seulement de ma volonté de leur procurer un bien qu’ils désirent avec raison, mais qu’il faut acquérir par de nouveaux efforts, puisque les conditions immenses que j’aurais accordées sont inutiles pour le rétablissement de la tranquillité publique. »
Cette lettre de Louis XIV à ses sujets n’est pas seulement émouvante, elle est aussi habile. Elle pousse à son comble l’indignation nationale, elle provoque un sursaut d’unité qui va même jusqu’aux protestants que le règne n’a pas ménagés. Partout l’on s’engage dans l’armée, c’est la patrie en danger avant Danton. Le duc de Villars, l’audacieux maréchal de France, va livrer sur la frontière du nord la bataille de la dernière chance. Le 11 septembre 1709, les deux armées sont face à face à Malplaquet, dans l’actuelle Wallonie belge. Si les armées françaises sont écrasées, la route de Paris sera ouverte, Louis XIV perdra son trône et la France sa puissance.
Sans vaincre, à Malplaquet les troupes françaises tiennent. Elles démontrent que la France n’est pas vaincue, qu’elle peut résister. La situation reste indécise encore pendant trois années qui voient les Français se ressaisir sans desserrer franchement l’étau autour d’eux. En 1712, la situation ressemble à celle de 1709 et Louis XIV est accablé, puni par Dieu, dit-on. Son fils bien-aimé sur lequel il fondait tant d’espérance est mort subitement en 1711. Son petit-fils devenu héritier du trône est mort au début de 1712 et l’aîné des arrière-petits-fils est mort aussi quelques jours plus tard. Trois dauphins de France viennent de disparaître en un an et l’héritier de la couronne est désormais un enfant de deux ans que les médecins ont oublié de soigner et donc de tuer (le futur Louis XV). Mais Louis XIV n’a perdu ni son sang-froid ni son flegme. En 1712, il renvoie Villars, guéri de sa blessure, aux armées pour une bataille à nouveau décisive pour Paris. Avant de le quitter, il demande à Villars ce qu’il conviendrait de faire si les armées françaises étaient vaincues. Villars garde un silence embarrassé. Le vieux monarque répond alors pour son général : « En attendant que vous me disiez votre pensée, je vous apprendrai la mienne… Je connais la Somme, elle est difficile à passer ; il y a des places : je compterais de me rendre à Péronne ou à Saint-Quentin, y ramasser tout ce que j’aurais de troupes, faire un dernier effort avec vous et périr ensemble ou sauver l’État, car je ne consentirais jamais à laisser l’ennemi approcher de ma capitale. » Villars est ému de cette confidence d’un homme de soixante-treize ans prêt à tous les sacrifices plutôt que de consentir à la fuite. « Les partis les plus glorieux, répond le maréchal, sont souvent les plus sages ; je n’en vois pas de plus noble que celui auquel Votre Majesté est disposée, mais j’espère que Dieu nous fera la grâce de n’avoir pas à craindre de telles extrémités. »
Prière entendue.
En effet, l’été verra une suite de batailles indécises. En 1713 et 1714, les coalisés lassés comprennent qu’ils ne vaincront pas la France et consentent à Louis XIV une paix beaucoup plus favorable pour lui que celle envisagée en 1709. Le calme et le sens de l’honneur du roi lui ont permis de préserver l’essentiel de son œuvre. À sa mort en 1715, il laisse une France plus grande, plus puissante et plus prospère que celle qu’il a héritée en 1642.
L’apparence d’un dilemme
En 1709, Louis XIV ne vit pas seulement une situation politique difficile. Certes les échecs des campagnes montrent qu’il a sous-estimé ses adversaires ou surestimé ses propres forces en décidant d’accepter le testament espagnol. Il se serait montré un politique présomptueux justement puni de sa présomption. Cette thèse est accréditée par Louis XIV lui-même. Le 26 août 1715, le roi au crépuscule de sa vie fait ses adieux aux siens. Il a compris que la gangrène de sa jambe ne laissait aucun espoir de guérison[4]. L’heure est venue de livrer son dernier combat. Il reçoit le Dauphin, âgé de cinq ans, et lui fait ses ultimes recommandations :
« Mignon, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra d’être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez autant que vous pourrez de faire la guerre : c’est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné sur cela ; j’ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l’ai soutenue par vanité. Ne m’imitez pas, mais soyez un prince pacifique, et que votre principale application soit de soulager vos sujets. »
Louis XV tiendra compte de ce conseil, il cherchera des compromis pour éviter les guerres et sera d’ailleurs accusé d’avoir « fait la guerre pour le roi de Prusse » – expression qui est restée en français – c’est-à-dire d’avoir accepté une paix trop favorable au roi de Prusse. La mercuriale que Louis XIV s’adresse à lui-même est néanmoins étonnante et injuste. La seule guerre qu’il pourrait s’accuser d’avoir entreprise « trop légèrement » est la guerre de succession d’Espagne, c’est donc à celle-là qu’il fait allusion. Et c’est aussi cette guerre qu’il pourrait s’accuser d’avoir « soutenue par vanité ». Louis XIV, sans doute attendri par sa fin prochaine, porte un jugement apparemment négatif sur ces événements de la guerre de succession d’Espagne. Mais ce regard et ce discours qui vont laisser l’image d’un Louis XIV sacrifiant le bonheur de ses peuples à sa vanité et à ses rêves de grandeur n’est pas conforme à la réalité historique. Louis XIV, bien au contraire, a ravalé toute vanité, a été jusqu’au bout de la honte pour obtenir la paix dont son peuple avait un urgent besoin.
En juin 1709, Louis XIV vit apparemment un dilemme, une situation dans laquelle aucune solution n’est acceptable. Il a un besoin absolu de la paix. Tout son comportement montre qu’il a compris cela, qu’il est convaincu du caractère impératif de ce besoin. Par ailleurs, la clause qui l’enjoint de faire la guerre à son petit-fils au cas vraisemblable où celui-ci refuserait de quitter le trône d’Espagne est au-delà des limites de l’acceptable. On pourrait imaginer que tiraillé entre ces exigences incompatibles, Louis XIV vive un dilemme terrible, qu’il s’abîme dans un stress épouvantable.
Or il n’en est rien. Il n’hésite pas, il ne se départit pas de son calme, tel un héros de tragédie grecque, il ne se plaint pas, il décide sans trembler et assume sa décision sans retenue, sans restriction, sans retour possible, par sa lettre à son peuple. Ce roi expérimenté n’a pas de doute sur ce qu’il doit faire dans ces circonstances difficiles. En un morceau de phrase il indique ce qu’il pense de ce qui lui est proposé, comment il juge ces conditions : « des conditions également contraires à la justice et à l’honneur du nom français ». Par ces quelques mots, Louis XIV révèle qu’il ne subit nullement le dilemme, qu’il sait clairement où se situe son devoir.
La décision de Louis XIV, bien qu’elle comporte un risque terrible pour le royaume, se résume en deux mots : « Non possumus ». Et ces deux mots ne donnent pas lieu à discussion. Ils n’expriment pas l’impuissance, l’absence de liberté mais tout au contraire une liberté fondée sur l’évidence. Quand Torcy rentre de La Haye, il sait probablement que Louis XIV va refuser cette paix honteuse, quels que soient les risques. À la cour également, ceci ne soulève aucune discussion. Nous ne pouvons pas, il y a dans cette paix quelque chose d’impossible qui s’impose à la réalité. La limite de ce que peut accepter le roi est franchie.
Les limites du réel
Les risques que court le royaume sont des risques réels. La réalité n’est pas objet de décision mais de connaissance. Les hommes n’ont pas eu à décider que la terre était sphérique mais à le savoir. À cette réalité, Louis XIV répond par une décision qui n’est pas fondée uniquement sur sa connaissance de la réalité. En effet, tout ce qu’il sait de la réalité et de ses dangers le conduit à conclure la paix. Ce n’est donc pas la réalité qui guide sa décision finale mais l’idée a priori qu’il se fait du possible et de l’impossible. Pour Louis XIV, il est impossible de faire la guerre à son petit-fils. Il ne s’agit pas là d’une réalité concrète et observable comme la sphéricité de la terre, d’une contrainte matérielle qui s’impose mais bel et bien d’une idée qu’a un acteur sur ce qui est possible et sur ce qui ne l’est pas.
Cette idée-là est si puissante qu’elle n’est pas discutée, elle n’est pas plus discutée qu’une réalité. Quand Louis XIV dit : « Non possumus », cela ressortit tellement à l’évidence que ces deux mots ne souffrent pas davantage discussion que s’ils affirmaient que les chats n’aboient pas. Autrement dit, le possible et l’impossible se sont substitués au réel et à l’irréel comme critères de décision. Parce que la limite a été atteinte.
Le possible et l’impossible sont les points limites du réel.
[1] Nous suivons pour cette partie la trame du livre de François Bluche : Louis XIV, Fayard, 1986.
[2] À l’époque, les Pays-Bas et les Provinces-Unies sont deux pays distincts.
[3] Marlborough était l’ancêtre de Churchill qui, Dieu merci, ne partageait pas les préjugés francophobes de son illustre aïeul. Churchill a d’ailleurs écrit une biographie de Marlborough.
[4] Il en mourra effectivement six jours plus tard, le 1er septembre.