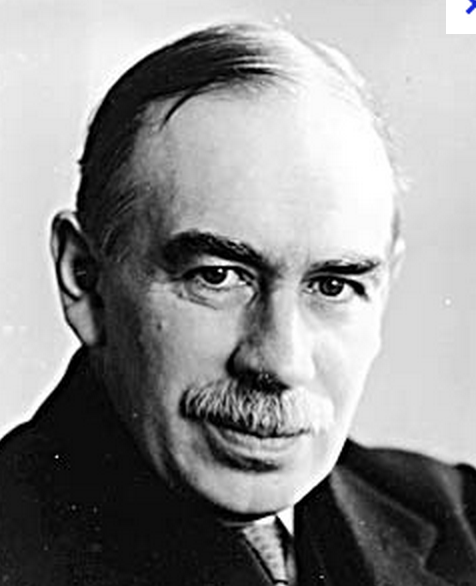Les principes de la grandeur
Égalité de droit et inégalité de fait
Je regarde la femme de ménage qui officie dans mon bureau. Elle est entrée avec un bonjour ténu, infime, au regard duquel le simple fait de respirer ferait figure d’insolence. Telle une souris prête à rentrer dans son trou à la moindre menace, cette jeune femme de couleur dont j’ignore tout se déplace en essayant de faire oublier sa présence. Toute son attitude exprime que rien ne pourrait la soulager davantage que d’être invisible. « Vous allez bien ? » Ma question l’a fait sursauter. Elle me jette un regard en dessous mais ébahi néanmoins et lâche dans un souffle qui paraît comme le dernier : « Oui ». « Comment vous appelez-vous ? » Cette fois-ci, elle me regarde plus franchement mais toujours apeurée : « Sophie. » À son immense soulagement, mon regard revient à l’écran de mon ordinateur. L’incident est passé, peu à peu l’ordre normal des choses reprend son cours. Comme à chacune de nos rencontres matinales et furtives, elle me voit passer des coups de fils et taper sur un clavier d’ordinateur et je la vois passer l’aspirateur et vider des corbeilles à papiers.
Elle se demande peut-être si je travaille pour de vrai ou si finalement parler au téléphone ça ne compte pas pour du beurre. Einstein aurait dit un jour : « Je comprends pourquoi il y a tant de gens qui aiment couper du bois, c’est une activité dont on voit tout de suite le résultat. » Elle se dit peut-être que je suis un type très fort de gagner ma vie en faisant une chose dont on ne voit pas le résultat : parler. Elle, quand elle a vidé la corbeille à papiers, cela se voit. Après, la corbeille est vide. Peut-être pense-t-elle plutôt que je suis un imposteur parmi d’autres. Mais plus probablement ne se dit-elle rien à mon sujet puisque je circule sur une orbite qui ne croise pas la sienne.
Sauf si je consens à lever les yeux de mon ordinateur pour me souvenir qu’une femme de ménage est un être humain.
En tout cas, je lui fais peur, c’est clair. Il n’y a pas d’égalité dans notre bref échange verbal dont j’ai eu d’ailleurs toute l’initiative. Il n’y a pas d’égalité parce qu’elle me prend pour un grand et qu’elle se prend pour une petite. Dans l’univers économique, dans le monde du travail, il y a des grands et des petits, ceux qui donnent des ordres et ceux qui les exécutent, ceux qui servent le café et ceux qui le boivent. Ce constat évident va à l’encontre de l’idée que nous sommes égaux. Il est d’ailleurs significatif qu’il m’appartienne de prendre l’initiative de ce dialogue. Si elle m’avait adressé la parole de sa propre initiative, c’eut été une faute professionnelle.
L’égalité de droit est pour nous une valeur constamment affichée. D’où cette question toute simple : comment une société et des organisations fondées sur le droit peuvent-elles justifier l’égalité en droit et l’inégalité en fait ? Comment supportons-nous cette permanente contradiction entre les situations inégalitaires que nous vivons et cette valeur d’égalité à laquelle nous nous prétendons attachés au point de l’afficher sur tous les frontons de la République ? Avec un « R » majuscule et un air minuscule.
Les postulats de justification
Il serait faux de croire que la grandeur est un sous-produit du capitalisme. En fait, dans les régimes communistes, il y avait aussi des grands et des petits, une nomenklatura et des gens du commun qui devaient faire la queue devant les magasins. Ces régimes avaient pourtant aboli la lutte des classes mais sous forme de grands et de petits, la différence des classes s’est reconstituée[1].
La réponse à la contradiction entre l’égalité de droit et l’inégalité de fait se trouve dans la justification[2]. Les inégalités ont besoin d’être justifiées. Cette justification sert à contenir la violence latente qui peut exister entre petits et grands. En effet, pourquoi les petits renoncent-ils à devenir grands à la place des grands ? En réalité, ils n’y renoncent pas toujours et de temps en temps, une révolution renverse l’ordre des choses, met les petits à la place des grands. De même, pourquoi les petits supportent-ils la condescendance des grands, quand ce n’est pas pire ?
La justification sert à éviter le renversement de l’ordre des choses, le remplacement des grands par les petits. Il s’agit donc d’un instrument de soumission destiné à préserver l’ordre existant.
D’après Laurent Thévenot et Luc Boltanski, les systèmes de justification ont tous la même structure qui résulte des mêmes postulats, que cette justification soit capitaliste ou communiste.
La justification sert aux grands à éviter que les petits prétendent à la grandeur. La grandeur des grands doit être justifiée par un discours. La justification fonctionne à partir de deux principes.
Premier principe de justification : principe d’investissement. Les grands sont grands parce qu’ils se sont investis, ils ont fait des sacrifices au service de la cité ou de l’organisation. Dans notre société, les grands ont passé des diplômes. Dans les entreprises, ils ont réalisé quelques faits d’armes, ont obtenu des succès exceptionnels. Ils ont travaillé dur pendant des années, n’ont pas ménagé leurs efforts. Bref, si on en est là où on en est, c’est bien grâce à eux.
Dans l’ordre politique, le grand s’est investi dans le militantisme. Il a conquis ses galons sur le terrain. On n’aime pas les parachutés dans la politique.
Toutefois, ce principe d’investissement est insuffisant même s’il est toujours évoqué. En effet, il fait référence à une règle du jeu. L’investissement s’est fait dans l’ordre d’une règle du jeu qui peut toujours être contestée par un processus révolutionnaire. « Je suis chef parce que c’est moi qui ai le meilleur diplôme, j’ai fait l’ENA. – D’accord, mais moi je pense que l’ENA est la catastrophe de la France. L’Irlande a l’IRA, l’Espagne a l’ETA, la France a l’ENA. » Le processus révolutionnaire est le moment où la règle du jeu qui fonde le principe d’investissement est elle-même contestée. La justification suppose donc un principe complémentaire.
Deuxième principe de justification : principe de bien commun. Ce principe suppose que plus le grand se hisse vers des états supérieurs, plus il contribue au bien de la cité. L’élévation de chacun est profitable à tous.
La distinction entre grands et petits ne contient pas seulement une inégalité, elle laisse supposer une divergence d’intérêts. Les grands ne seraient-ils pas grands au détriment des petits ? Telle est bien la thèse marxiste : les capitalistes exploitent par définition la classe ouvrière. Et s’il y a divergence d’intérêts entre grands et petits, cela légitime la lutte armée comme mode de relation entre grands et petits. Autrement dit, les petits ont tout intérêt à installer des piquets de grève partout, voire à sortir le fusil. La relation entre grands et petits est potentiellement conflictuelle et il s’agit de peser sur le rapport de forces.
Une telle situation fondée sur le rapport de forces permanent est très défavorable à la production de valeur. Pour en sortir, les grands vont donc expliquer aux petits qu’il n’existe pas de divergence d’intérêts, que plus ils s’élèvent dans l’ordre des grands, mieux cela vaut pour tout le monde. Si les riches s’enrichissent, c’est que l’économie fonctionne bien, c’est donc que l’on crée de l’emploi, c’est donc que les pauvres peuvent sortir de la pauvreté en trouvant du travail.
Telle est la thèse capitaliste : une bonne dose d’inégalité est efficace et favorable à chacun car elle permet de rémunérer les facteurs de production selon leur juste contribution. Tant que l’on reste d’ailleurs dans l’ordre de l’économie, cette thèse se tient. Il est de fait qu’il vaut mieux être pauvre dans un pays riche que de faire partie des classes moyennes dans un pays pauvre.
Ce principe de bien commun a tout de même ses limites. Certes, une certaine dose d’inégalité peut avoir un rôle d’incitation. Pourquoi un jeune ferait-il des études d’ingénieur, longues, coûteuses et difficiles, s’il ne peut pas ensuite monnayer son diplôme ? Mais ce principe sert aussi à justifier l’injustifiable. Certaines inégalités de revenus du travail résultent en fait de situations de pouvoir bien plus que de l’efficience économique. On voit qu’aux États-Unis des p-dg ont des salaires exorbitants, de plusieurs centaines de millions de dollars par an, alors qu’en Europe on s’en tient à quelques millions d’euros par an (ce qui n’est déjà pas négligeable). Aucun fait ni aucune théorie n’a démontré que de telles rémunérations ont une efficacité économique. On pourrait plutôt supposer le contraire puisque les États-Unis, après avoir donné des leçons de vertu et d’éthique des affaires au monde entier avec leurs fameuses normes comptables, ont dû avouer piteusement que certains de leurs dirigeants de grandes entreprises s’étaient comportés comme de vulgaires escrocs. Vulgaires sans doute mais surtout onéreux. Avec la complicité de leurs commissaires aux comptes estampillés des meilleures maisons qui elles aussi donnaient des leçons d’éthique au monde entier.
En Europe, toujours modestes, nous n’avons pas su conjuguer la malhonnêteté à l’incompétence, nous contentant dans certains cas de l’incompétence, incompétence flamboyante et raisonneuse du temps de la bulle Internet. Tout cela n’a rien à voir avec l’efficacité et tout à voir avec l’abus de pouvoir. De même, l’efficacité économique ne requiert nullement les rémunérations exorbitantes des banquiers d’affaires lors des fusions – acquisitions. Cette rémunération est souvent de l’ordre de 5 % de la valeur de l’entreprise vendue. C’est-à-dire que pour vendre une entreprise, les banquiers parviennent à s’approprier 5 % de l’ensemble de la valeur créée par les travailleurs de l’entreprise au cours de son histoire. Le bien commun fonctionnerait aussi bien avec une rémunération plus raisonnable. Ces 5 % sont le fait d’une position de force, ils ne participent pas au bien commun mais capturent de la valeur créée par d’autres.
Ce principe de bien commun est sympathique parce qu’il nie les divergences d’intérêts. Or mon métier de consultant en stratégie me montre chaque jour que l’économie est parcourue de divergences d’intérêts qui ne sont pas résolues par l’équité au sens de l’économie – c’est-à-dire la rémunération effective du facteur travail – mais purement et simplement par le rapport de forces entre les acteurs.
« La Foire aux vanités »
Dans ce merveilleux roman intitulé La Foire aux Vanités[3], William Thackeray présente, à travers des personnages tous plus sots ou ambigus les uns que les autres, la thèse suivante : les hommes sont prêts à supporter le malheur, beaucoup de malheur, pourvu que leur vanité soit satisfaite. Ils sont même prêts à provoquer ce malheur, celui d’autrui avec insouciance, le leur avec légèreté. Le roman est peuplé d’officiers stupides et impécunieux dont la grande satisfaction est de regarder les civils de haut, de jeunes femmes non moins stupides qui bêlent d’amour devant les officiers plastronnant tandis que leurs rêves ne servent que de menue monnaie d’échange, de vieillards riches qui veulent s’élever dans l’ordre de l’aristocratie qui ne les reçoit pas, d’intrigants ambitieux et plus intelligents que les autres qui cherchent à tirer à leur profit les ficelles de la vanité.
L’habile romancier montre qu’une fois que la mécanique de la vanité est remontée, les personnages ne pourront que parcourir indéfiniment une orbite qui les mène du malheur au désastre puis du désastre au malheur plus grand. Ils n’ont aucunement les qualités morales et les capacités intellectuelles pour sortir de ce cycle romanesque.
Roman balzacien en un sens, le récit de Thackeray possède de plus cette richesse de ne pas attacher la vanité à un seul personnage comme l’aurait fait Balzac qui typait ses personnages, mais d’en saturer l’air qu’ils respirent. La vanité chez Thackeray n’est pas une qualité que l’on va reconnaître chez tel ou tel, c’est le mécanisme de l’horloge qui meut la société. Sa vision du monde ne s’incarne pas en un personnage, elle les intoxique tous avec des manifestations diverses. L’auteur ne se prive pas de rappeler, lorsque nous risquons de trouver les personnages trop stupides, trop grossiers, que nous sommes sur la scène de la foire aux vanités et que sur cette scène, rien en fait de bêtise ne saurait offenser la vraisemblance.
C’est aussi le roman de l’Ecclésiaste : « Vanité des vanités, tout est vanité, dit Qohéleth, vanité des vanités, tout est vanité. »[4]
Sans pousser la thèse jusqu’à ce terme qui prétend que tout est vanité, il n’est néanmoins pas difficile de constater qu’il existe de par le monde une foire aux vanités. C’est-à-dire que les hommes sont prêts à faire des efforts – parfois maladroits – pour influencer l’opinion que les autres auront d’eux. Pour une opinion meilleure que la réalité.
Il ne faut d’ailleurs pas jeter sur cette foire aux vanités un regard uniquement négatif puisqu’elle pousse les hommes à agir, qu’elle est un des ressorts de l’ambition. La foire aux vanités existe aussi dans le monde du travail comme dans tous les groupes humains, elle y a d’ailleurs trouvé un champ d’expression.
La foire aux vanités dans le travail s’oriente selon deux axes : la hiérarchie (et subsidiairement le revenu et le pouvoir) et la compétence.
La différence hiérarchique ou la différence de compétence sont les deux moyens par lesquels je peux faire sentir à l’autre que nous ne sommes pas tout à fait pareils. Et il se peut, cela est humain, qu’au moment où je fais sentir cela à l’autre, ma vanité en soit flattée, en ressente cette petite joie ridicule de l’ego qui enfle.
La spécialisation des compétences et la hiérarchie sont des phénomènes consubstantiels à l’entreprise, c’est-à-dire qu’ils sont la cause même de l’efficacité de l’entreprise. Or ces deux phénomènes viennent constamment flatter la vanité des hommes affamés de vanité comme les fumets de la cuisson du gibier sous les remparts viennent agacer les assiégés mourant de faim.
Si L’Ecclésiaste nous avertit avec vigueur contre les dangers de la vanité, c’est clairement que la faim de vanité va à l’encontre de l’égalité de dignité à laquelle nous invite l’Évangile. Reste à savoir si l’homme est cet affamé de vanité que nous décrit Thackeray et si sa recherche de compétence et de pouvoir trouve là sa principale source.
Dans un tel cas, l’Évangile serait voué à rester indéfiniment un joli texte sans prise sur la réalité. Il inviterait les hommes à délaisser ce qui est pour eux l’essence même de ce qui les anime. S’il faut de la vanité et du mépris pour mouvoir le monde, ce ne sont pas les valeurs chrétiennes de respect et d’amour qui vont l’emporter au fur et à mesure que le monde s’anime, se développe, aiguise les compétences, les hiérarchies, les classements, etc.
L’Évangile reconnaît bien qu’il y a deux voies, mais que la porte est étroite et « peu nombreux ceux qui la trouvent »[5].
L’homme face au mépris, vanité des vanités
L’obsession des classements est sans doute une manie moderne. Tous les sports font l’objet de compétitions, avec des classements extrêmement précis, les élèves et les étudiants sont impitoyablement classés, les admissions se font sur concours et c’est bien souvent le classement qui va déterminer le travail de toute une vie.
Les classements scolaires ont leur logique et leur subtilité un peu ridicules mais qui imprègnent plus ou moins la mentalité de ceux qui ont parcouru ces arcanes allongées d’innombrables chicanes. Dans tous les cas et à tous les stades, il s’agit d’organiser un naufrage pour voir qui sait nager. Que le naufrage laisse quelques mauvais souvenirs dans l’esprit de ceux qui ont coulé ne semble pas être considéré comme un souci. Je répète souvent à mes enfants qu’on ne va pas à l’école pour avoir de bonnes notes ni même pour travailler mais pour apprendre et acquérir le goût d’apprendre. Naturellement, ils me prennent pour un toqué inconséquent.
Une fois que nous en avons fini avec les classements scolaires, la manie des classements ne nous lâche pas pour autant. Classé au tennis et au golf, classé dans l’entreprise avec les fameux entretiens d’évaluation qui donnent lieu parfois à une note comme à l’école, classé ou pas dans les listes de hauts potentiels[6].
Peut-on durablement espérer qu’on nous lâche enfin à notre mort, qu’à la cérémonie funéraire on n’énonce pas tous les classements que nous avons obtenus au cours de notre vie ? Eh bien non, la rubrique nécrologique du Figaro nous offre chaque jour des défunts sortis d’écoles prestigieuses et ayant glané au cours de leur glorieuse existence des présidences nombreuses et non moins prestigieuses dont pas une ne sera omise, pour le grand profit du Figaro qui s’est acquis le quasi-monopole de la présidence en bière. La vanité ne rend pas les armes devant la mort, bien au contraire elle lui jette comme un dernier et dérisoire défi. Comme si, avec ses présidences, ses légions d’honneur, ses anciens élèves de pataphysique, le défunt ne subissait pas le sort commun du miséreux qui le même jour est enterré discrètement. Comme s’il emportait un peu de ses hochets dans l’autre monde, pareil à ces pharaons que l’on a retrouvés enterrés au milieu des plus somptueuses richesses et ceints de prodigieux bijoux.
La foire aux vanités de Thackeray est celle de la naissance, du titre (épouser un baronnet à tout prix), des rentes ou du moins de l’apparence des rentes. La foire aux vanités moderne, dans le travail, s’est fixée sur les diplômes, les titres, le pouvoir, le salaire, les présidences, les décorations, les oripeaux du pouvoir comme la voiture de fonction, le chauffeur, la taille du bureau et la légendaire épaisseur de la moquette.
Tout cela commence par des classements qui justement vous classent dans ou hors d’une caste.
Nous avons simplement oublié au passage que les classements sont toujours relatifs à un seul ordre des choses. Ils sont tous relatifs car ils se réfèrent tous à une échelle particulière dont le sens est de toute façon limité.
Lorsque nous pensons qu’autrefois les hommes tiraient vanité de leur naissance, de leur nom, de leurs ancêtres, de leurs quartiers de noblesse, la vanité de la foire aux vanités nous apparaît dans toute son ampleur. Car L’Ecclésiaste n’attire pas notre attention sur la vanité mais sur la « vanité des vanités ». Selon les époques, les vanités s’accrochent à des formes diverses. Mais le phénomène reste le même, toujours aussi vain qui nous empêche de regarder l’autre dans sa dignité.
En septembre 1968, j’avais douze ans et je me trouvais à l’hôpital, cloué à mon lit de souffrance par une tenace péritonite. Pendant quelques jours, je partageai ma chambre avec un prêtre de Chambéry qui se montrait à mon endroit d’une exquise douceur et d’une parfaite gentillesse entre deux lectures pieuses. Un jour il me dit : « Aujourd’hui, mon évêque va venir me voir. » Un évêque était pour moi, à l’époque, un personnage considérable. Je fréquentais sans gloire une école religieuse, j’entendais parler de bondieuserie du matin au soir et j’avais bien intégré que j’étais un petit, un tout petit, et que l’évêque était un grand. Quelqu’un qui avait rencontré le pape ! Un évêque dans ma chambre ! Comment allais-je me rendre assez petit, disparaître sous mes draps, pour ne pas perturber le conciliabule avec le prêtre ?
Entre l’évêque de Chambéry (qui était-il ?, j’ignore tout de lui petit homme sec au regard bienveillant qui me fait immédiatement penser à l’évêque de Digne qui change la vie de Jean Valjean). Il salue le prêtre puis regarde la pièce, me voit et se dirige vers moi. « Qui es-tu ? », me demande-t-il avec une douceur où je reconnais l’œuvre de l’Esprit Saint. Puis, après ma première réponse, toujours sur le même ton de charité, il s’enquiert longuement de ma vie et de ma santé. Après quoi, il retourne auprès du prêtre pour sa visite et enfin se retire.
Le prêtre et moi restons un moment silencieux. Puis, je lui dis : « Il sait faire preuve de simplicité, votre évêque ! » À ma grande surprise, car pour ma part après cette entrevue je baigne dans les capiteuses délices de l’authentique charité, le prêtre répond avec une pointe de mauvaise humeur ou de désappointement : « Oui, peut-être trop de simplicité. »
Je supposai alors que l’évêque de Chambéry (de 1968) faisait preuve en toutes circonstances dans son ministère de la même bénigne gentillesse avec les humbles que celle qu’il m’avait manifestée sans nécessité apparente. Je supposai aussi que c’était pour certains laisser trop peu de place à la dignité d’évêque et qu’il ne manquait peut-être pas de bonnes âmes pour le regretter. Un évêque sans vanité est-il complètement un évêque ? En tout cas, il s’agit d’une situation où un manager au travail, l’évêque en l’occurrence, indique comment l’Évangile s’incarne dans sa pratique de manager.
Je n’étais pas un criminel à racheter, je ne ferai donc pas Les Misérables de la gentillesse d’un évêque. Une simple pensée dans mes prières devrait être à la hauteur de l’événement. Cette histoire montre que l’Église est une organisation, comme les entreprises, que des gens y travaillent, comme dans les entreprises, et qu’à ce titre elle est parcourue parfois par les mêmes mécanismes de vanité et donc d’irrespect de la dignité de chacun. La mauvaise humeur du prêtre était assez inattendue. Mais elle était bien là.
[1] Blague de l’époque communiste : un homme entre dans un magasin à Moscou et demande du pain. On lui répond : « Monsieur, vous faites erreur. Ici c’est le magasin où il n’y a pas de viande. Le magasin où il n’y a pas de pain, c’est en face. »
[2] Nous suivons ici l’argumentation de Laurent Thévenot et Luc Boltanski : De la Justification, Les économies de la grandeur, Gallimard, 1991.
[3] William Thackeray : La Foire aux Vanités, Gallimard, 1994. Thackeray, auteur anglais du XIXe siècle, est assez peu connu et encore moins lu en France aujourd’hui, mais Stanley Kubrick a heureusement donné vie avec un très beau film à l’un de ses romans : Barry Lindon. Dans Barry Lindon, la vanité n’a peut-être pas le rôle principal, mais le héros est néanmoins un joli coquin dénué du moindre idéalisme.
[4] Qo 1.2.
[5] Matthieu 7.13-14.
[6] Car dans certaines entreprises, on ne se contente pas de savoir ce que vous êtes, on sait aussi ce que vous serez, on connaît votre potentiel. Comme souvent, l’ignorance se drape dans une prétention aux multiples replis.