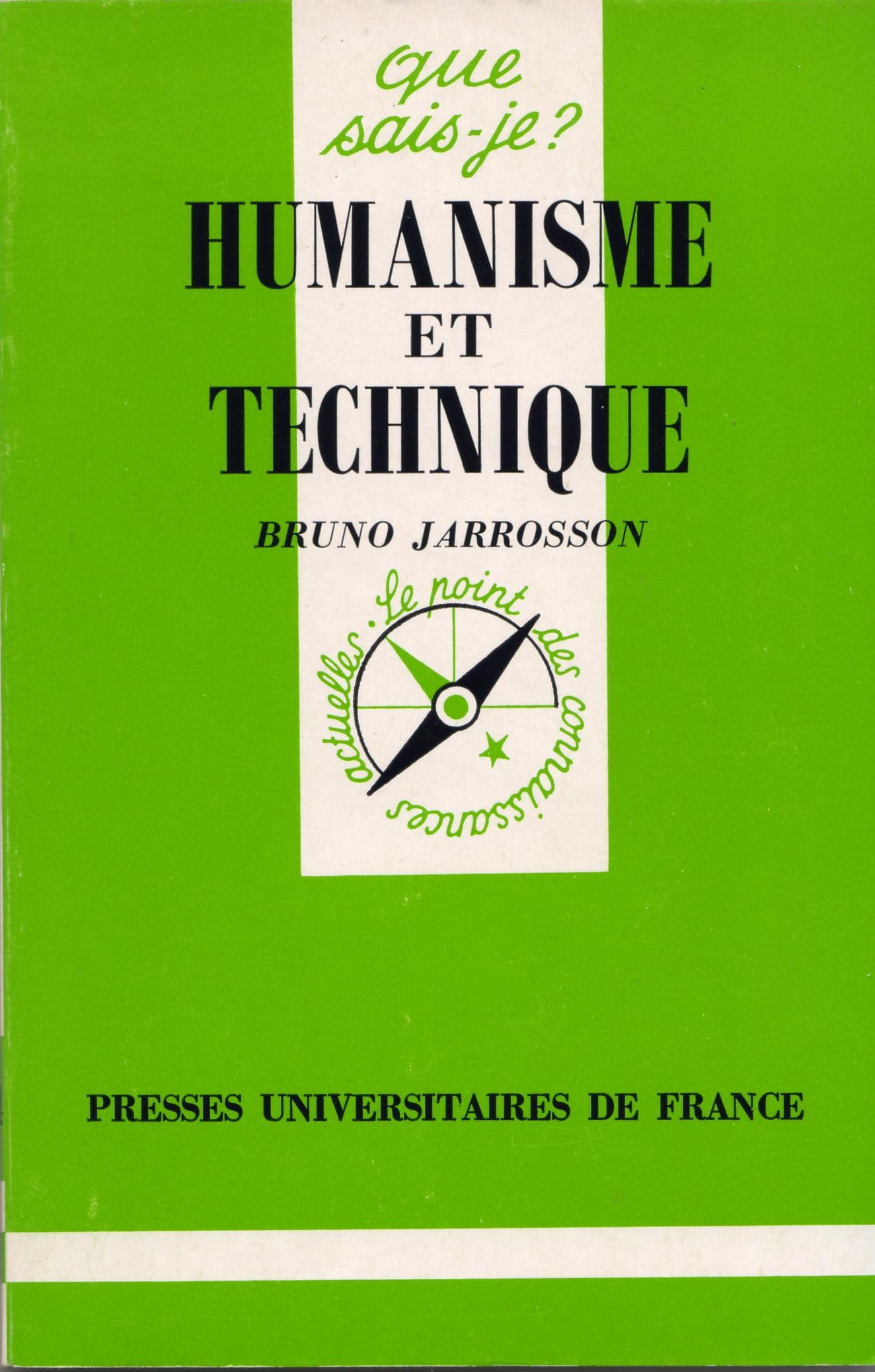Les lois de la liberté et le songe
La vie est un songe
Le prince Sigismond, héritier imaginaire du trône de Pologne et principal personnage de La vie est un songe (1631 – 35), drame de Pedro Calderon de la Barca[1], est une création originale du théâtre espagnol qui pose la question du rapport au réel. Basyle, roi de Pologne, qui se pique d’astrologie, s’est laissé prédire que son fils Sigismond deviendra un prince indigne et qu’après avoir, en naissant, coûté la vie à sa mère, il le privera de son trône. Pour conjurer cette malheureuse prédiction, le roi enferme secrètement Sigismond dans une tour environnée de montagnes réputées inaccessibles, sous la garde du fidèle Clothalde. Une vingtaine d’années plus tard, regrettant la violence exercée contre la liberté de son fils et préoccupé de sa succession en raison de son grand âge, le roi est décidé à donner une chance à Sigismond. Pour ne pas hypothéquer l’avenir cependant, il conçoit un curieux stratagème : faire monter Sigismond sur le trône et l’observer sans lui faire savoir qu’il est le prince héritier. Si Sigismond déjoue le présage, il deviendra roi, sinon il sera remis en prison. Cette expérience décidera donc du sort du prince. Le roi fait endormir Sigismond qui se réveille avec stupeur à la cour avec toutes les prérogatives du prince héritier. Hélas, Sigismond se comporte avec fureur, il jette un courtisan par la fenêtre. Il se montre arrogant et répond brutalement aux remontrances de son père. Basyle doit reconnaître avec tristesse que les astres n’ont pas menti. Le roi fait donc endormir à nouveau Sigismond et le fait reconduire dans sa cellule. Quand Sigismond se réveille et fait part de ce qu’il a vécu, Clothalde feint la surprise et lui explique qu’il a rêvé.
Mais l’histoire s’ébruite et le peuple, indigné du procédé employé par le roi à l’encontre de son fils, libère Sigismond. S’ensuit une brève guerre civile remportée par Sigismond. Basyle se prosterne devant son fils. Sigismond explique alors dans une harangue à toute la cour que le destin peut être dominé par le sage. Il montre les errements commis à son égard par le roi. Après quoi il relève le roi prosterné et se rend à lui. Celui-ci le nomme aussitôt héritier de la couronne qu’il vient de mériter par ses exploits et sa sagesse.
Rêve et réalité
Le drame se déploie autour du destin de Sigismond qui a des réactions alternées selon qu’il se réveille prince ou que, replié sur lui-même, il se trouve à nouveau dans un cachot. Le philtre aidant, une confusion s’empare de son esprit au sujet de ces deux situations successives. Il ne sait plus si la vie est une réalité ou un songe. Quand donc sera-t-il sûr de vivre la vraie vie ? Quelle référence peut-elle asseoir la certitude ?
Le passage subit de l’extrême dénuement au luxe princier, de l’impuissance à la toute puissance, de l’indignité à la majesté, puis la perte de tout cela, puis la conquête à nouveau offrent l’image de la diversité de la scène du monde, du pauvre au riche et du manant au roi. D’où le scepticisme radical qu’exprime Sigismond après son retour au cachot :
« Le roi songe qu’il est un roi, et vivant
dans cette illusion il commande,
il décrète, il gouverne ;
et cette majesté, seulement empruntée,
s’inscrit dans le vent,
et la mort en cendres
la charge, oh ! cruelle infortune !
Qui peut encore vouloir régner,
quand il voit qu’il doit s’éveiller
dans le songe de la mort ?
Le riche songe à sa richesse, qui ne lui offre que soucis ;
le pauvre songe qu’il pâtit
de sa misère et de sa pauvreté ;
il songe, celui qui triomphe ;
il songe, celui qui s’affaire et prétend,
il songe, celui qui outrage et offense ;
et dans ce monde, en conclusion,
tous songent ce qu’ils sont,
mais nul ne s’en rend compte.
Moi je songe que je suis ici,
chargé de ces fers,
et j’ai songé m’être trouvé
en un autre état plus flatteur.
Qu’est-ce que la vie ? Un délire.
Qu’est-ce que la vie ? Une illusion,
une ombre, une fiction ;
le plus grand bien est peu de chose,
car toute la vie n’est qu’un songe,
et les songes rien que des songes. »
Sigismond connaît, en accéléré, les tentations et les délices de l’humaine condition qui le font succomber à l’orgueil. L’orgueil semble maître du monde, mais le monde n’est qu’une fiction, un spectacle illusoire qui conduit à la mort ses captifs. Que faire qui ne soit vain si la vie n’est qu’un songe ? Il faut donc trouver une autre voie que celle de l’orgueil, une voie qui passe par la découverte de la liberté.
Déterminisme et liberté
Au-delà de l’action, le drame chemine vers une source universelle à travers l’angoisse de Sigismond qui prend peu à peu conscience du difficile cheminement de sa liberté. Sous cette question immédiate du songe et de la réalité se cache une autre exigence, celle de l’expression de la liberté entre volonté et morale. Dans un premier monologue au début de la pièce, Sigismond, enchaîné et couvert de peaux de bêtes, se demande en vertu de quelle loi l’homme est la moins libre de toutes les créatures.
« L’oiseau éclôt et les parures
de sa beauté resplendissante
à peine ont-elles fait de lui
fleur emplumée ou bouquet d’ailes,
que le voici vélocement
parcourant l’espace éthéré,
se refusant à la douceur
du nid tranquille qu’il délaisse,
et moi pourvu d’une âme plus
grande, j’ai moins de liberté ,
La bête naît et les dessins
des belles taches sur sa peau,
font à peine d’elle un signe étoilé
- grâce au docte pinceau -
que, dans l’audace et la fureur,
l’humaine nécessité
lui enseigne la cruauté,
du labyrinthe en fait le monstre,
et moi dont l’instinct est meilleur
aurai-je moins de liberté ?
Le poisson naît, qui ne respire,
avorton d’ulves et de frai,
et à peine, vaisseau d’écailles,
sur l’onde se voit-il,
que le voici de tous côtés,
qui mesure l’immensité
de toute la capacité
que lui offre le centre froid.
Et moi, avec mon libre arbitre,
aurai-je moins de liberté ?
Le ruisseau naît aussi, couleuvre
qui se coule entre les fleurs,
et à peine serpent d’argent,
entre les fleurs se brise-t-il,
qu’il célèbre par sa musique
la tendresse des fleurs
qui lui offrent la majesté
des champs qui s’ouvrent sur son passage ;
et moi qui jouis de plus de vie,
aurai-je moins de liberté ? »
Cette question revient dans le second monologue, cité plus haut, qui suit le « rêve » du passage à la cour du roi. De nouveau enchaîné, l’esprit troublé, Sigismond se dit que s’il n’est pas possible de distinguer le rêve de la réalité, on peut du moins, dans le rêve comme dans la réalité, distinguer et pratiquer la vertu. Fatalité ou liberté : telle est l’alternative dans laquelle se débat Sigismond. Les hommes ne doivent pas confondre leurs terreurs et leurs espoirs avec les desseins de la providence. Les horoscopes, les signes imposent aux vies un canevas précis. Le roi Basyle a su déchiffrer, grâce à l’étude de l’astrologie et des mathématiques, le grand livre du firmament et ses constellations dorées, ses globes de cristal et ses cercles de neige. Mais l’action lui montrera que cette science ne suffit pas, il faut aussi savoir en faire bon usage. Dans la scène finale, Sigismond dit à son père :
« Ce qui dans le ciel est déterminé,
ce que sur les tables d’azur
Dieu a écrit avec son doigt,
dont tous ces feuillets d’azur
ornés de lettres dorées
offrent l’énigme abrégée ;
tous ces signes jamais ne mentent ;
celui qui ment en effet et qui trompe
est celui qui pour en mésuser
les déchiffre et cherche à les comprendre. »
Le roi Basyle devient à ses dépens l’instrument de sa perte en abondant dans le sens des événements prédits par les astres. En enfermant son fils comme une bête fauve, en le privant de façon tyrannique de toute liberté, en le dépossédant de ses droits et de sa dignité, le roi s’est fait le complice du destin. Pire encore, il transforme en destin une hypothèse sur laquelle la volonté et la vertu pouvaient agir. Il devient ainsi l’auteur de ce qu’il voulait éviter. Mais ce triomphe des présages est provisoire et prépare un triomphe plus éclatant encore, celui de la liberté. Les événements de la destinée ne sont pas annulés mais orientés différemment par l’emprise qu’acquiert sur eux Sigismond. C’est en fait Basyle qui a permis ce triomphe de la liberté en donnant une chance à Sigismond, contre l’avis des oracles. Basyle agit de façon contradictoire et ambiguë. L’enchaînement des situations donne par deux fois, à Basyle et à Sigismond, la leçon suivante : le mensonge, la peur, l’abus de pouvoir, la défiance ne mènent qu’au malheur et à la mort. Par contre, l’éducation, l’intelligence, la science, la maîtrise des passions éclairée par le discernement assurent l’exercice de la liberté dans le cadre de la sagesse. Et cette sagesse est la véritable vocation de l’homme.
Le privilège de l’homme sur la bête, le privilège du libre-arbitre, n’est pas accordé par Dieu mais doit être gagné par la volonté d’échapper à la servitude de ses instincts. Même si cela est ressenti comme un sacrifice (mais un sacrifice dont on ignore s’il n’est pas lui aussi un rêve). Alors que la vie est inconstante et éphémère, la vertu, elle, est connue. Le drame s’inscrit dans les grands débats du Moyen Âge et la Renaissance : prédestination et grâce, saint Augustin et Pélage, Érasme et Luther. Il annonce la formulation kantienne de la liberté à travers l’impératif catégorique.
La prophétie ne sera pas accomplie comme dans les tragédies grecques. Sigismond montre la force de la volonté et de la dignité de l’homme face au sort des astres qui prétendent la nier. Le drame de Sigismond est celui de la liberté et de la solitude. Impuissantes sont les âmes à communiquer entre elles et aucune révolte – même populaire – ne saurait les faire sortir de leur prison. Ce n’est pas pour le pouvoir que lutte Sigismond, ni même pour la liberté mais pour la conquête de lui-même. Aussi n’est-il sauvé par aucun des personnages, ni par l’amour, ni par la chance mais par un effort personnel dont le seul théâtre est son château intérieur. Sigismond retourne à son profit le dilemme qui lui est posé entre rêve et réalité en affirmant sa liberté, en devenant un personnage vertueux qu’aucun déterminisme n’annonce.
L’occultation de l’angoisse chez Heidegger[2]
Le philosophe allemand Martin Heidegger a repris à son compte l’ancienne et toujours actuelle question de Leibniz : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » La quête de la réponse à cette question va le conduire à un aperçu original sur l’humanisme contemporain et sur sa manifestation : l’action humaine.
Aucun philosophe au xxe siècle n’a posé comme Heidegger l’action humaine comme une recherche de l’être essentiel au-delà des multiples reflets des apparences que nos décisions façonnent en vain. Derrière la scène visible des choses matérielles se joue en coulisses une partie où s’investit une quête d’absolu, où l’accomplissement de notre humanité est à la fois promis et différé. Telle est l’hypothèse fondamentale du père de l’existentialisme allemand.
Pour traiter de la question de Leibniz, Heidegger distingue trois modalités d’être : les étants, l’être et le Dasein ou être-au-monde. Les étants désignent les objets apparents, ce que nous voyons du monde. Mais la tradition philosophique a reconnu dès son origine que les étants n’étaient pas l’être, qu’il y a des choses derrière les choses, des Idées au-delà des apparences, des noumènes derrières les phénomènes. La métaphysique et l’épistémologie prétendent partir à la recherche de l’être au-delà de l’horizon borné des étants et la philosophie est bel et bien la science de l’être, de l’immuable derrière ce qui change, des lois éternelles de la nature au-delà de leurs manifestations diverses. Elle interroge l’être en interpellant les étants. Heidegger s’inscrit en radicale opposition par rapport à cette méthode. Il accuse tous les philosophes, à part Kant, d’avoir recherché en fait d’être une sorte d’étant suprême qui échapperait au temps. De Platon à nos jours, la science recherche des lois immuables de la nature.
Pour Heidegger, il ne saurait être question de rechercher l’être dans ce qui échappe au temps car le temps n’est rien d’autre que lui-même. Il n’est pas ceci ou cela, il ne se laisse pas définir par un quelconque concept extérieur à lui-même. L’être participe nécessairement du temps. Heidegger pense donc que la philosophie, en recherchant l’intemporel, a occulté l’être au profit des étants sous prétexte de le rechercher. Tel serait le grand mirage, la soutenable erreur, la fausse promesse de la quête de l’essentiel. Martin Heidegger se donne pour objectif de renverser cette tradition. Pour ce faire, il introduit la notion de Dasein (littéralement : « être là »). Le Dasein est « le moment d’ouverture constitutif de l’homme dans son rapport le plus immédiat aux choses ». L’homme constitue un cas particulier dans l’univers des étants car il a conscience d’être, il s’ouvre à l’être par autre chose que sa simple nature d’étant. L’homme possède cette double nature d’être un étant (un objet de la nature) et une conscience transcendantale, c’est-à-dire une conscience qui peut se penser comme étant, comme un fait. L’homme est cet étant qui peut prendre conscience d’être, il a donc la possibilité de révéler l’être dans l’étant et possède, en ce sens, une pré intuition de l’être. Par sa conscience d’être un étant, l’homme tient une figure de ce truchement ténu entre le fait d’être là jeté dans le monde et la conscience qui, en percevant le monde, n’est pas totalement présente au présent. « Le Dasein, jeté au milieu de l’étant, accomplit en tant que libre une percée dans l’étant ». L’homme s’aperçoit enclos dans l’horizon du temps, « être-pour-la-mort », « jeté-dans-le-monde ».