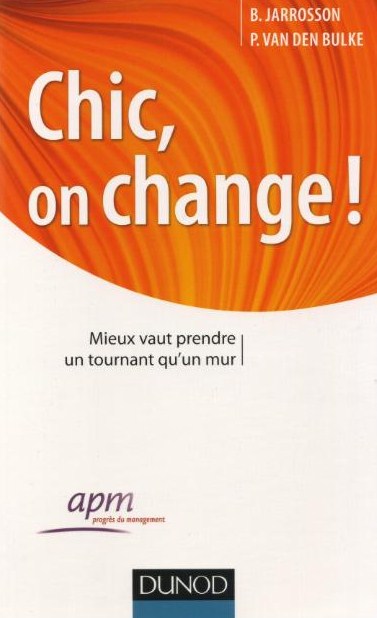Les figures imposées du changement
« Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Surtout quand elles sont veuves. »
Georges Clemenceau
Première figure imposée : la fascination du mieux ou l’oubli de la perte
Un chef d’entreprise raconte : « J’ai acheté une entreprise qui fabriquait du fromage de chèvre. » Le savoir-faire de ce chef d’entreprise consistait à acheter des entreprises, à optimiser le process industriel et à les revendre. Pas à la façon des dépeceurs d’entreprise. Juste en optimisant le process industriel. Pas le patron prédateur.
En général, les entreprises qui fabriquent du fromage de chèvre ne sont pas dans le huitième arrondissement de Paris. On les trouve plutôt à la campagne. Le chef d’entreprise constate que les soixante ouvriers emportent tous du fromage pour leur consommation personnelle. Ça le défrise un peu. Comme ça le défrise, il va vérifier sur les marchés et dans les commerces que ces fromages ne sont pas revendus, qu’il s’agit bien de consommation personnelle. Et il constate qu’il n’y a pas de dérive. Les ouvriers prennent juste ce qu’il leur faut pour leur consommation. Peut-être un peu pour leur belle-mère aussi mais il faut bien survivre en univers hostile.
Pas de chance, il a un contrôle URSAFF qui, naturellement, fait une remarque. Il s’agit d’un avantage en nature non déclaré. Mais comme le contrôleur est du pays, il n’en dit pas plus et appelle seulement à la vigilance. Pas de redressement mais on l’invite tout de même à trouver la solution à ce problème.
Il réfléchit, il évalue la consommation des ouvriers, il la multiplie par deux et il officialise le fait. La part de fromage devient un droit officiel. Il réunit tout le monde en rappelant ce qu’était la tradition de l’entreprise – la part officieuse de fromage – et en annonçant que désormais la nouvelle règle du jeu, c’est une part deux fois plus importante. Il montre que les ouvriers ne sont pas lésés, bien au contraire. « Je maintiens la tradition mais je l’officialise. Je vous autorise officiellement à prendre cela. »
Cela a mis un chaos dans son entreprise car les ouvriers en ont fait plus qu’un fromage. Ceci à cause d’une perte non identifiée. Il faisait perdre la face à ses ouvriers en leur disant qu’ils n’étaient pas honnêtes. Il a perdu la confiance de son personnel. « Qu’est-ce que c’est que ce patron ? Non seulement il nous rachète, mais parce qu’il nous rachète, c’est lui qui doit nous dire combien de fromages on peut prendre. Comme si nous n’étions pas honnêtes. » De son propre aveu, il ne s’en est jamais remis.
Quand un patron arrive avec une idée de changement, il est en général persuadé que ce qu’il veut faire est très bien. C’est bien pour l’entreprise, c’est bien pour son avenir, c’est bien pour les hommes dans l’entreprise. Il a préparé son affaire, il a analytiquement raison. Il est prêt, c’est-à-dire fasciné par le mieux qu’il va apporter à l’entreprise. Quand il communique son idée, avec un superbe power point en quadrichromie, il est un peu surpris de ne pas déclencher l’enthousiasme béat que lui semble mériter son plan de changement, si intelligent, si favorable, si créateur de valeur pour l’entreprise. Syndrome de Sarkozy. Il recommence, il repasse le même sermon. Pourquoi renoncer à une communication qui a si bien échoué ? Les couleurs du power point ne sont pas mal, après tout. Même recul circonspect chez ceux qui écoutent.
Car ceux qui écoutent ont en tête une question qui est peut-être occultée dans le discours : qu’est-ce que je vais perdre ? Dans toutes les situations de vie, un projet de changement s’accompagne de la perte de quelque chose. La perte pouvant être subjective puisqu’au moment où on parle du changement, le changement n’a pas encore eu lieu et la perte éventuelle n’est pas avérée.
La première question fondamentale des figures imposées est donc : qu’est-ce qu’ils vont perdre ?
Il n’existe pas de projet de changement sans perte. Et n’oubliez pas que dans la perte, c’est une pièce de leur monde à eux qui part, pas une pièce de votre monde à vous. Vous ne savez pas ce qu’est le puzzle de leur monde et il est souvent difficile de l’identifier. C’est la raison pour laquelle il faut aborder le problème de la perte frontalement. Il y a une crainte de changement. Et ce n’est pas l’évolution du monde avec ce que l’on raconte sur les effets anonymes de la mondialisation qui va rassurer.
Comme on a peur des pertes, on craint parfois d’aborder le sujet. Or il va falloir reconnaître ces pertes puisque de toute façon elles existent, il va même falloir les compenser.
Quand on parle avec des patrons des changements passés, ils réagissent souvent en regrettant d’avoir oublié le problème des pertes. Comme on sait que ce sera probablement difficile, comme on a peur du changement, on cherche plutôt à l’imposer. Ce qui risque de le rendre plus difficile encore. On n’a pas l’humilité de dire ce qui sera perdu. La proximité managériale dont on se gausse consiste à s’intéresser à ce qui se passe dans leur monde. C’est une pièce de leur monde à eux qui part.
La question de la perte peut expliquer des réactions disproportionnées. On ne sait jamais exactement ce que l’on va déclencher comme réaction.
C’est une pièce de leur monde à eux qui part
On change un horaire de travail, on change un lieu, on change la façon dont les copines se retrouvent, etc. C’est une pièce de leur monde à eux qui part. La clé du management de proximité, c’est de prêter attention aux gens en prêtant attention à ce qui est important pour eux.
Parfois, les patrons pensent compenser l’oubli de la perte par la fascination du mieux. On explique combien c’est mieux. « C’est tellement mieux, ce que je vous raconte, que vous allez le croire. » Mais la fascination du mieux est un truc très patronal. Dans le cerveau des salariés s’affiche instantanément ce qu’ils vont perdre. La fascination du mieux est un beau sujet pour visionnaire, mais ce n’est pas très concret. En y travaillant, en élaborant sa stratégie visionnaire, le patron a modifié son paysage mental. Il le voit déjà fini, son changement idéal, il le voit déjà installé et il oublie cette première étape, cette perte.
Cette idée de perte attire l’attention sur les règles non écrites. Toutes les organisations ont des règles de fonctionnement implicites, des modes de régulation qui leur sont propres. Les employés des organisations se nourrissent toujours un petit peu sur la perte.
Deux règles ou deux conseils donc : ne pas oublier la perte et ne pas s’imaginer que la fascination du mieux compensera la perte.
Soyons lucides sur le fonctionnement de l’organisation. L’entreprise est « volée » par ses salariés, le premier vol étant du temps. Le deuxième vol étant quelques blocs-notes. Parce que ce n’est pas grave, c’est l’entreprise qui paie. Le troisième vol c’est le téléphone. Le quatrième vol, c’est la consultation de sites Internet pour préparer les vacances ou le projet immobilier. Il faut être lucide par rapport à cela et trouver le bon dosage. Qu’est-ce qui est acceptable ? Et qu’est-ce qui ne l’est pas ?
La grande distribution qui est particulièrement volée par ses salariés régule ces dérives en faisant des exemples. Tu as volé un pain au chocolat ? Tu es licencié. Un pain sans chocolat ? Tu es chocolat quand même, comme dirait Copé à Fillon. Évidemment, ça fait la une de la presse régionale, évidemment le juge prud’homal condamne le patron qui est un salaud par définition. À ce détail près qu’il s’agit d’une faute grave avec flagrant-déli. Finalement, ce battage sert l’objectif régulateur du patron. La grande distribution perd un à deux pourcents de son chiffre d’affaires en démarque inconnue. La plus grande part est due au personnel plutôt qu’aux clients. Le coût de la lutte contre cette démarque inconnue peut être exorbitant. D’où l’idée de faire des exemples. C’est efficace pour la marge nette dans ce monde de marge brute. Le coût de la sécurité maximale par la technique (caméra, etc.) est trop important pour qu’on y arrive.
C’est un bout de leur monde qui part et pas du vôtre, il faut donc écouter ce qu’il y a dans leur monde. Écouter ne veut pas dire que l’on renonce à une stratégie qui a été mûrement réfléchie mais que l’on est prêt à négocier dans le temps la mise en œuvre de cette stratégie. Un plat de fraises n’est bon que s’il est mangé, une stratégie ne sera bonne que si elle est mise en œuvre. Ce qui suppose une phase d’écoute, de prise en compte de ce monde.
Deuxième figure imposée : vendre le problème et non pas la solution du problème
Quand on observe une organisation, on y trouve deux catégories de personnes. Il y a ceux qui travaillent, qui produisent, qui « délivrent » comme on dit aujourd’hui, et il y a ceux qui se posent les problèmes de l’organisation. Ce ne sont pas les mêmes.
Ceux qui se posent les problèmes de l’organisation travaillent aussi. Et leur travail, c’est de résoudre les problèmes qu’ils se sont posés. Quand ils ont trouvé les solutions aux problèmes qu’ils se sont posés, ils vont voir les autres, ceux qui produisent. Et ils leur disent : « J’ai la solution et cette solution implique un changement. Et d’ailleurs, c’est vous qui allez changer, ce n’est pas moi. »
Et là, c’est fou de voir l’énergie qui est dépensée pour vendre aux autres les solutions à des problèmes qui ne leur ont pas été posés. D’où le slogan : « Vendez le problème et pas la solution du problème. » En trouvant les mots adaptés à chacun : niveau opérationnel, problèmes opérationnels, niveau organisationnel, problèmes organisationnels, niveau stratégique, problèmes stratégiques. Ne demandons pas à un ouvrier de production de revoir la politique marketing du groupe. Il ne sait pas faire et il s’en fout. Par contre, si on lui demande comment gagner dix minutes dans le montage d’un frigidaire, il a probablement des idées intelligentes. Et si on ne les lui demande pas, il ne les dira pas.
Le problème du changement se concentre donc sur la capacité qu’ont les patrons – sans inquiéter inutilement, mais sans mentir non plus – de vendre les problèmes que collectivement nous devons résoudre. Beaucoup de cadres ont le syndrome de la bonne copie, c’est-à-dire qu’ils pensent qu’ils sont payés pour trouver des solutions. Les ingénieurs ont été sélectionnés là-dessus, ils ont pensé à tout. Ils ont été sélectionnés sur leur capacité à trouver dans un temps limité une solution unique, sachant qu’on a toutes les données du problème, la bonne solution étant celle du professeur. Ensuite, dans la vie professionnelle, il faut éventuellement résoudre des problèmes mal définis dont on ne sait pas où sont les données, dans un temps indéfini et dont on ne sait pas s’ils ont une solution unique ou aucune ou plusieurs. Avec en prime l’idée qu’il ne faut peut-être pas les résoudre, ces fameux problèmes, mais les partager. Les solutions qui fonctionnent ne sont pas les solutions parfaites mais celles que les gens peuvent faire fonctionner.
Ce qui n’est pas la même chose.
Ah non mais…
Quand on observe une entreprise de l’extérieur, en tant que consultants, on est d’abord frappé par l’importance des dysfonctionnements, sur lesquels d’ailleurs le personnel aime bien s’appesantir auprès du consultant. Mais cela n’empêche pas que l’entreprise marche ainsi et l’objet du changement ne sera pas de la faire fonctionner à la perfection. Comment va-t-on la faire évoluer sans l’empêcher de marcher ?
Les gens dont le métier est de réfléchir au fonctionnement de l’organisation peuvent avoir un mode de raisonnement extérieur à l’organisation, un raisonnement idéaliste qui est le suivant : c’est nul et je dois construire un système parfait. Alors qu’en réalité, ce n’est pas nul puisque ça marche quand même – inutile d’insulter le passé mais s’appuyer sur lui – et l’objet du changement n’est pas de construire une organisation parfaite. L’objet du changement est de se demander si on peut faire mieux.
Dans les belles présentations power point en quadrichromie que l’on fait aux comités de direction ou aux séminaires des cadres, on propose toujours le parfait. Avant notre action tout était nul et après notre action, nous ululerons dans les capiteuses délices de la perfection. Voilà qui prépare de la déception.
Il faut viser le mieux, pas le parfait. Il faut être avant d’être parfait. Le schéma « problème – solution » issu des mathématiques ne connaît pas ce moyen terme : la solution est juste ou fausse.
Gad Elmaleh dans un sketch se plaint de n’avoir pas son correspondant au bout du fil quand il a fait neuf chiffres justes sur dix. « On devrait l’avoir, même en solution dégradée. Je ne sais pas, moi… J’ai fait neuf chiffres justes sur dix et j’ai 0 % de mon interlocuteur. Ce n’est pas juste, je devrais avoir droit à quelque chose, tout de même. » Cette blague marque la différence entre sciences molles et sciences dures. Dans le monde des sciences dures et de la technique logique, il n’y a pas de moyen terme entre le vrai et le faux. Le monde sociologique, le monde analogique des sciences molles n’est fait que de degrés entre le moins bon et le meilleur.
La projection de la pensée logique sur le monde analogique est paralysante. Le mode de pensée scientifique ne prépare pas forcément à aborder le changement dans un monde analogique et imparfait.
Le passé n’est jamais nul, la preuve c’est que l’entreprise est là. On doit se méfier d’une posture diachronique qui consiste à dire que l’on oublie le passé et qu’on part sur une tout autre voie. Cette posture ne fonctionne que si tout le monde est absolument convaincu que l’on ne peut pas faire autrement. Par exemple s’il y a peur de la fermeture ou peur de perdre son emploi. Dans la plupart des cas, il vaut mieux être synchronique, c’est-à-dire trouver dans le passé les points d’appui du changement. Ce qui suppose d’accepter un fonctionnement dégradé par rapport à la perfection.
Vendre le problème suppose un effort de modestie et de lucidité, la sortie de la raison arrogante. Il faut se mettre autour de la table et dire que l’on a un problème en commun à affronter. Donc que l’on n’a pas toutes les solutions. C’est un acte managérial symboliquement très fort car il est difficile pour un patron de reconnaître qu’il ne peut pas tout et qu’il ne sait pas tout.
Le changement passe par le découronnement.
Lionel Jospin premier ministre avait provoqué un scandale en disant que l’État ne pouvait pas tout lors de la fermeture de l’usine Renault de Vilvoorde. Cette affirmation d’une infinie banalité sortait de la raison arrogante et brisait le mythe du leader omniscient et omnipotent. Affirmation aussi évidente qu’inacceptable.
Le patron qui arrive à dire – ne serait-ce qu’à un consultant – « Je ne sais pas ce qu’il faut faire » commet un acte très fort. Beaucoup de gens n’en sont pas capables.
Troisième figure imposée : le syndrome du donjon
Si tu es en haut du donjon, tu vois le bout de la plaine. Si tu es en bas du donjon, tu vois le bas du pont-levis. Ce n’est pas que tu es plus con, c’est juste que tu es plus bas. Si celui qui est en haut du donjon va voir celui qui est en bas du donjon et il lui dit : « On voit au bout de la plaine », il n’obtient pas de réaction intéressante. Puisqu’il parle à celui qui est en bas de quelque chose qu’il ne voit pas.
S’il lui dit au contraire : « On voit dans cette direction-là. Après le pont-levis, il y a une petite éminence. On va d’abord aller là », pour le coup, il se situe dans le champ de vision de celui qui est en bas du donjon.
Ceci actualise une vieille idée trop souvent oubliée : il n’existe pas de projets de changement réussis sans fabrication de succès intermédiaires. Quels sont les succès intermédiaires que l’on a fabriqués pour baliser le parcours que l’on avait à faire ?
C’est un élément clé de la conduite du changement qui ouvre deux voies de réflexion.
Première voie de réflexion : on ne reste jamais seul pour faire un changement. Il faut toujours une coalition autour du changement. Cette coalition peut être de taille variable, mais on ne conduit pas seul un projet de changement.
Comment fabrique-t-on une coalition ? Ce n’est pas parce qu’on met un comité de direction autour d’une table qu’il a forcément confiance dans la vision du patron.
Deuxième voie de réflexion : l’intention du regard fait la chose regardée.
On dit à quelqu’un : « Vous avez quinze secondes pour regarder ce sac puis vous cessez. » Premier type de regard. Ensuite on dit à la même personne : « Vous allez regarder ce sac puis après vous devrez le dessiner, avec un papier et un crayon. » Dès que les sujets commencent à dessiner, on les arrête et on leur demande s’ils ont regardé la même chose les deux fois. Ils répondent que non. Entre le premier et le deuxième regard, l’intention n’était pas la même. La première fois il s’agissait de regarder, la deuxième fois de dessiner. L’intention du regard modifie ce que l’on voit. Ce sont les fumeurs qui repèrent les tabacs dans les rues.
Le succès intermédiaire modifie le regard. Quand on veut faire apprendre un adulte, on doit se demander par quel succès intermédiaire il faut commencer. Les enfants sont pour la plupart capables de surmonter les échecs, les adultes beaucoup moins. Une situation de changement est une situation d’apprentissage. Si je veux faire progresser un adulte, je dois me demander par quel succès intermédiaire je dois le faire passer. Ce que l’on appel le périmètre proximal de développement.
Ceci est d’ailleurs dérivé de la théorie des thérapies brèves. Une fois que l’on a défini le problème, une fois que l’on a défini les solutions déjà tentées pour résoudre le problème, la question-clé est de préciser quel est le premier signe qui montrerait que l’on est sur la bonne voie pour résoudre le problème.
Bien sûr que le patron est en haut du donjon et voit le bout de la plaine. C’est son rôle. Mais dans le même temps, il doit procéder à partir du champ de vision de ceux qui ne voient que le pont-levis