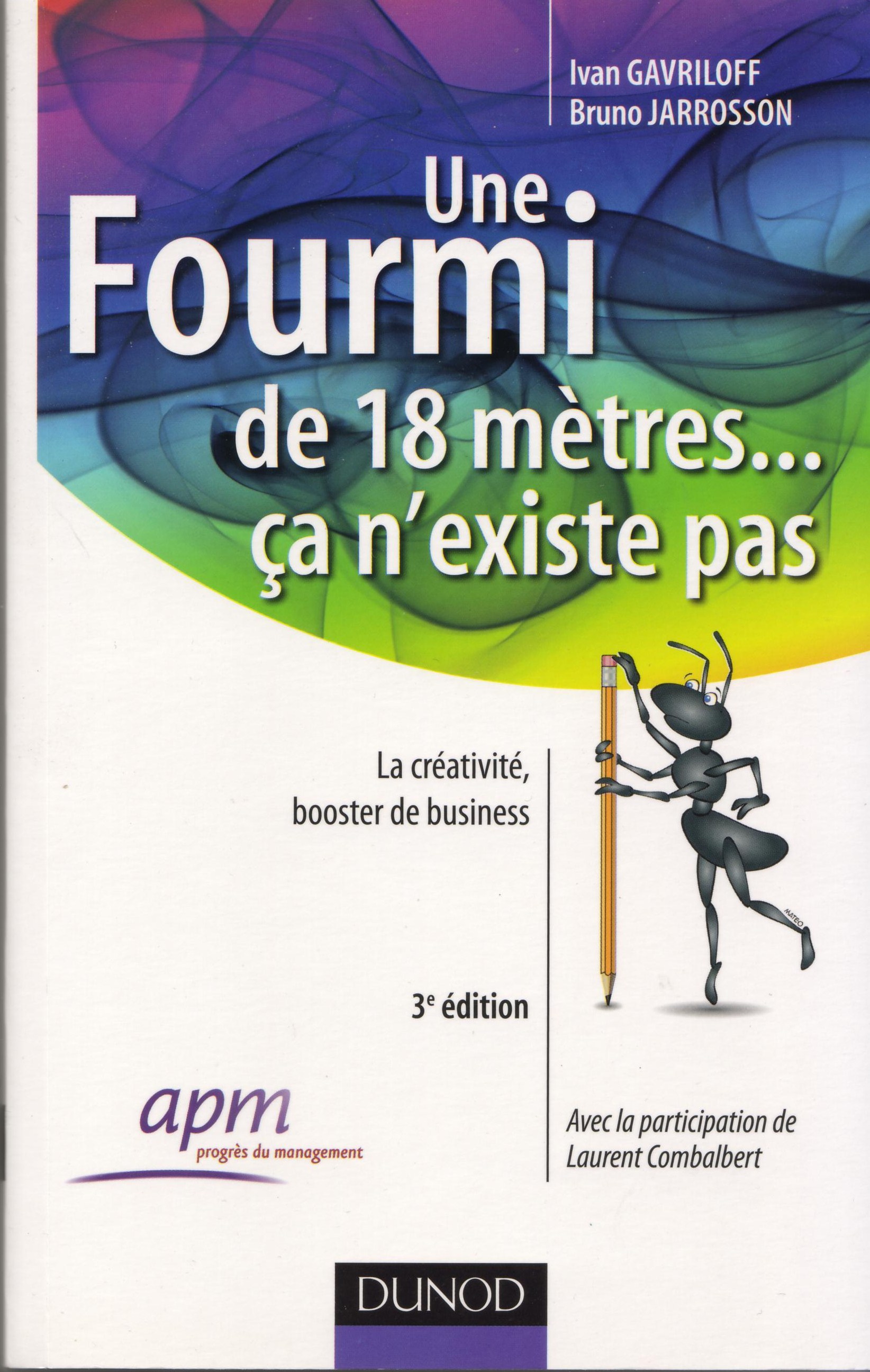Lâcher la selle : faire confiance
La confiance qui construit
Gabriel, quatre ans et demi, veut apprendre à faire du vélo qu’il a eu pour Noël. Une grande allée goudronnée d’environ deux cents mètres. Son père le met en selle, comme font tous les pères, tient le vélo par la selle, et court. Quelques allers retours. L’enfant ne se débrouille pas trop mal. Père et fils discutent de quelques points techniques. Équilibre, comment tenir le guidon, contrôler la direction pour ne pas filer sur le trottoir.
Moment crucial. Si je ne lâche pas la selle, il n’y arrivera jamais. Si je la lâche, ne va-t-il pas tomber, se faire mal, se décourager ? Il y a quelque chose d’illogique dans la confiance.
Premier essais. Avant le départ, père et fils conviennent que le père lâchera la selle pendant trois mètres, tout en gardant la main sous la selle. Après, il reprendra la selle. C’est ce qui est fait. Tout se passe normalement au niveau de l’équilibre. Par contre, le contrôle de la direction n’est pas suffisant. On en reparle pour l’améliorer.
Bon, maintenant il faudrait vraiment y aller. Le père a une idée. Le mieux, se dit-il, ce serait que je le lâche plus longtemps sans qu’il le sache, en gardant la main sous la selle. Comme ça, s’il tombe, je le rattrape, s’il ne tombe pas, je lui annonce qu’il sait faire du vélo. Gagnant sur tous les tableaux. Logique.
C’est une bonne idée, se dit-il, sauf… Sauf qu’il y a un « sauf ». Je dis tout à Gabriel sauf que je le lâche. Et dans ce « sauf », il y a une catastrophe potentielle. S’il croit que je le tiens, alors qu’en fait je ne le tiens pas et qu’il tombe parce que je n’ai pas pu le rattraper, on aura du mal à faire équipe, ensuite. Exit, donc, l’idée du double jeu.
Finalement après un dernier réglage technique, Gabriel est d’accord pour que son père le lâche vraiment. On part. Il tient cent mètres. Son père court à côté de lui, sans laisser la main sous la selle. Au bout de cent mètres, Gabriel faiblit. Il reste cent mètres pour arriver au bout de l’allée. Son père lui dit : « Si tu vas au bout, tu as un Kinder Surprise ». Le Kinder Surprise (œuf en chocolat contenant un petit objet en pièces détachées) pour un enfant de quatre ans et demi, c’est l’équivalent des six numéros gagnants du loto pour un smicard. Gabriel appuie sur les pédales et termine ses deux cents mètres, à la surprise de son père.
La confiance que l’on donne à l’autre l’aide à réussir. Tout le monde sait cela. D’où la recette de management bien connue : dire à l’autre qu’il va réussir pour le faire réussir. « Tu vas y arriver. » Phrase dangereuse : et s’il n’y arrive pas ? Si l’on dit à l’enfant : « Tu peux y aller, je sais que tu ne vas pas tomber », et qu’il tombe ? C’est aussi dangereux que d’affirmer : « Je dis la vérité » quand ce n’est pas le cas.
Sur la bonne foi, Kant contre Machiavel
Cette idée de ne pas tromper Gabriel repose sur une vision relativement moraliste des relations entre les hommes sans d’ailleurs préciser si elle se voulait efficace ou morale. Plutôt que d’étudier ce point philosophique, nous allons le confronter à son opposé : le cynisme de Machiavel. Cynisme qui lui ne se veut nullement immoral mais plutôt amoral. Il n’a en vue que le lien entre les moyens et les résultats, il ne connaît que l’efficacité. Or, la vision de l’efficacité de Machiavel est à l’opposé de la nôtre. Et sa vision mérite considération par sa qualité. Pour bien situer les termes du débat, nous allons partir d’un long passage du Prince (chapitre XVIII).
« Chacun entend assez qu’il est fort louable à un prince de tenir sa parole et de vivre en intégrité sans ruses ni tromperies. Néanmoins on voit par expérience que les princes qui, de notre temps, ont fait de grandes choses, n’ont pas tenu grand compte de leur parole, qu’il ont su par ruse circonvenir l’esprit des hommes, et qu’à la fin ils ont surpassé ceux qui se sont fondés sur la loyauté.
Il faut donc savoir qu’il y a deux manières de combattre, l’une par les lois, l’autre par la force : la première est propre aux hommes, la seconde aux bêtes ; mais comme la première bien souvent ne suffit pas, il faut recourir à la seconde. Ce pourquoi il est nécessaire au prince de savoir bien pratiquer et la bête et l’homme. […]
[…] Partant, un seigneur avisé ne peut tenir sa parole quand cela se retournerait contre lui et quand les causes qui l’ont conduit à promettre ont disparu. D’autant que si les hommes étaient tous gens de bien mon précepte serait nul, mais comme ils sont méchants et qu’ils ne te tiendraient pas parole, etiam tu n’as pas à la tenir toi-même. Et jamais un prince n’a manqué d’excuses légitimes pour colorer son manque de parole ; on pourrait en alléguer d’infinis exemples du temps présent, montrant combien de paix, combien de promesses ont été faites en vain et réduites à néant par l’infidélité des princes, et que celui-ci qui a mieux su faire le renard s’en est toujours le mieux trouvé. Mais il faut savoir bien colorer cette nature, être grand simulateur et dissimulateur ; et les hommes sont si simples et obéissent si bien aux nécessités présentes, que celui qui trompe trouve toujours quelqu’un qui se laissera tromper. […]
[…] Il n’est donc pas nécessaire à un prince d’avoir toutes les qualités ci-dessus nommées, mais de paraître les avoir. Et même, j’oserai bien dire que, s’il les a et qu’il les observe toujours, elles lui porteront dommage ; mais faisant beau semblant les avoir, alors elles sont profitables ; comme de sembler être pitoyable, fidèle, humain, intègre, religieux ; et de l’être, mais s’étant bien préparé l’esprit, s’il faut ne l’être point, à pouvoir et savoir faire le contraire. Et il faut noter qu’un prince, surtout quand il est nouveau, ne peut bonnement observer toutes ces conditions par lesquelles on est estimé homme de bien ; car il est souvent contraint, pour maintenir ses États, d’agir contre sa parole, contre la charité, contre l’humanité, contre la religion. »
Machiavel, Le Prince
Au cynisme de Machiavel s’opposera le rigorisme de Spinoza (« L’homme libre n’agit jamais en trompeur, mais toujours de bonne foi ») et surtout de Kant avec son impératif catégorique. Ces deux penseurs, à l’inverse de Machiavel, affirment que la liberté s’exprime par la loi morale. La loi morale étant définie par la possibilité d’universaliser la maxime d’une action « […] je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime devienne une loi universelle. » La première section des Fondements de la métaphysique des mœurs répond précisément à Machiavel du point de vue de cette universalisation :
« Et pourrais-je bien me dire : tout homme peut faire une fausse promesse quand il se trouve dans l’embarras et qu’il n’a pas d’autre moyen d’en sortir ? Je m’aperçois bientôt ainsi que si je veux bien vouloir le mensonge, je ne peux en aucune manière vouloir une loi universelle qui commanderait de mentir ; en effet, selon une telle loi, il n’y aurait plus à proprement parler de promesse, car il serait vain de déclarer ma volonté concernant mes actions futures à d’autres hommes qui ne croiraient point cette déclaration ou qui, s’ils y ajoutaient foi étourdiment, me payeraient exactement de la même monnaie : de telle sorte que ma maxime, du moment qu’elle serait érigée en loi universelle, se détruirait elle-même nécessairement. » Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs.
Autrement dit, la tromperie n’est pas universalisable.
Il peut sembler qu’il s’agisse là d’une querelle de moralistes mais hors de notre propos puisque nous n’entendons pas définir une morale universelle pour l’entreprise. Nous nous intéressons dans ces pages à l’utilité, à l’efficacité. Soit.
Cependant, l’argumentation de Machiavel se fonde sur l’utilité personnelle : on ment si on y a intérêt. Et à y regarder de plus près, l’argumentation de Kant est elle aussi empreinte d’utilité même s’il a en vue une utilité universelle plutôt qu’une utilité particulière. Kant dit en substance que la tromperie est un système destructeur du point de vue de la collectivité. La différence entre Kant et Machiavel n’est donc pas essentiellement morale, mais elle tient plutôt à l’espace sur lequel ils définissent l’utilité : utilité particulière ou utilité générale.
Or cette tension entre intérêt personnel et intérêt collectif est au cœur de la vie de l’entreprise. L’entreprise est en effet une collectivité solidaire de fait. L’intérêt particulier de chacun dépend de l’intérêt collectif. Mais chacun peut être tenté de rechercher son intérêt particulier au détriment de l’intérêt collectif. À quelle condition une telle collectivité peut-elle prospérer ?
La tentation de Machiavel
Nous avons dit que si l’on veut faire confiance, il faut le faire à 100 %, que si on ne le fait qu’à 99 %, le 1 % restant détruira le bénéfice de la confiance. On a affirmé que l’on doit dire sa vérité à 100 %, que seulement 1% de restriction suffira à la rendre non crédible. Cette affirmation introduit la tentation de Machiavel : paraître faire confiance à 100 % tout en ne faisant pas confiance, paraître sincère en ne l’étant point. Bref, être un bon comédien. Machiavel est formel, les princes qui ont adopté cette attitude s’en sont bien portés, ils ont obtenu la meilleure efficacité. Ils sont arrivés à leurs fins plus efficacement que les autres. Ceci est à rapprocher de l’observation faite par les psychiatres que les situations révolutionnaires favorisent l’accession au pouvoir des paranoïaques (Robespierre, Staline). Se méfiant de tout le monde, ils éliminent leurs adversaires sans trembler. Paranoïaques de tous les pays, méfiez-vous !
Notre conviction, et nous abandonnons ici toute morale, est que, contrairement à ce que prétend Machiavel, les manipulateurs sont flairés comme tels. Talleyrand n’a jamais cherché à se faire passer pour quelqu’un de pur comme le cristal. Ce qui nuit à l’efficacité dans l’entreprise, c’est une différence très grande entre ce que l’on est et ce que l’on prétend être, même si cette différence n’est jamais réductible à rien. On pardonne aux autres ce qu’ils font plus facilement que ce qu’ils sont. On pardonne plus facilement l’erreur que le mensonge. Machiavel écrivait dans un siècle sans médias, dans un système où le manipulateur n’était pas confronté à celui qu’il manipulait, et à propos d’un système politique où la coopération ne jouait pas le rôle essentiel qu’elle joue aujourd’hui dans la vie des entreprises. Le monde est devenu un vaste système coopératif, c’est une des raisons pour lesquelles il est plus sûr et plus prospère qu’au temps de Machiavel. La tentation de Machiavel demeure nonobstant. En particulier dans les situations de négociation, puisque la négociation gère une tension entre la coopération et le conflit. Nous pensons cependant qu’elle ne prend pas en compte la mutation logique à laquelle nous invite un monde dont les liens coopératifs se resserrent chaque jour. La télévision a vaincu le communisme. À l’usure.
On se plaint beaucoup de l’affaiblissement de la morale des affaires et on attribue souvent cet affaiblissement à l’anonymat résultant de la mondialisation. Plus le monde est vaste, plus on peut impunément tromper un grand nombre de gens. Mais à cet anonymat immoral du vaste monde s’oppose l’intimité morale du réseau, de l’entreprise, du groupe. Plus notre monde est menacé par une dangereuse immoralité, plus la solidarité des groupes se fonde sur l’honnêteté de chacun vis-à-vis des autres.
Faire confiance aux autres jusqu’au bout suppose une vision particulière de l’autre. Posons a priori que toute personne, même le pire criminel, désire aimer et être aimée. Répondre positivement à la confiance sincère dont on bénéficie est un moyen d’être aimé. De même que l’on agresse ce qui vous menace, on aime ce qui procède d’un acte d’amour. Dans la confiance jusqu’au bout, il y a sans doute le pari que l’amour permet d’établir une relation coopérative. La probabilité que l’autre réponde positivement à cette position de la relation – souhaitant lui aussi aimer et être aimé – est alors assez grande. Le criminel Mesrine, dans son ultime confession, disait : « Je n’ai jamais voulu tout le mal que j’ai fait mais je n’ai pas été aimé. » Mesrine n’était pas seulement cette bête dangereuse que l’on a dû abattre par ruse. La relation conflictuelle, la trahison, marquent l’incapacité à toucher la zone d’amour. Cependant cette zone existe toujours.
La confiance appelle la confiance comme la méfiance appelle la méfiance. La confiance libère l’énergie.
On constate souvent cette difficulté à toucher juste dans les entreprises avec des syndicalistes opposants purs et durs. Des casseurs ? Quand on les écoute, on entend plutôt un discours moral : « Je veux que la dignité de l’homme soit respectée. » Quand elle l’est, ces opposants irréductibles, ces casseurs impénitents, deviennent souvent les éléments les plus efficaces de l’entreprise. « Je vomirai les tièdes », est-il dit dans l’Écriture.
Dans sa relation à l’autre, on choisit de fait la confiance ou la défiance. Ce choix se transmet à l’autre. La confiance créée la confiance, la défiance alimente la défiance. Le chef d’entreprise, sur ce point, choisit pour toute l’entreprise.
A-t-on raison de faire confiance ? La confiance est un phénomène relationnel. L’attitude de l’autre se calquera sur la mienne. La clé de la libération de l’énergie de l’autre est la confiance en l’être. La défiance nie l’absolu de l’être et donc la dignité de l’autre.
Soit, et alors ? Gagne-t-on plus d’argent avec la confiance qu’avec la méfiance ? La confiance n’est-elle pas le fait de managers tendres dans un monde de marges brutes ?
Cette question de confiance ou de défiance ne supplée sans doute pas à une stratégie bien conçue. Cela étant, dans les comptes de l’entreprise, des milliers de petits ruisseaux dont chaque salarié détient une source, font de grandes rivières. La confiance fait renaître ces petites sources de prospérité, diminue les gaspillages, fait revenir les clients, etc. On observe dans chaque cas de retournement de la défiance en confiance un rétablissement des comptes. Alors oui, la confiance est une façon efficace de faire gagner de l’argent à une entreprise. Dans son livre La société de la confiance : essai sur les origines et la nature du développement humain[1], Alain Peyrefitte montre que le développement, qu’il appelle « divergence », est lié à des pratiques fondées sur la confiance. Le premier sentiment, ancestral, que nous éprouvons face à l’autre peu et mal connu est la méfiance. La confiance ne peut advenir qu’à l’issue d’un apprentissage mutuel et consciemment voulu.
Il faut que l’autre sache quand on lâche la selle.
[1] Éditions Odile Jacob, 1995.