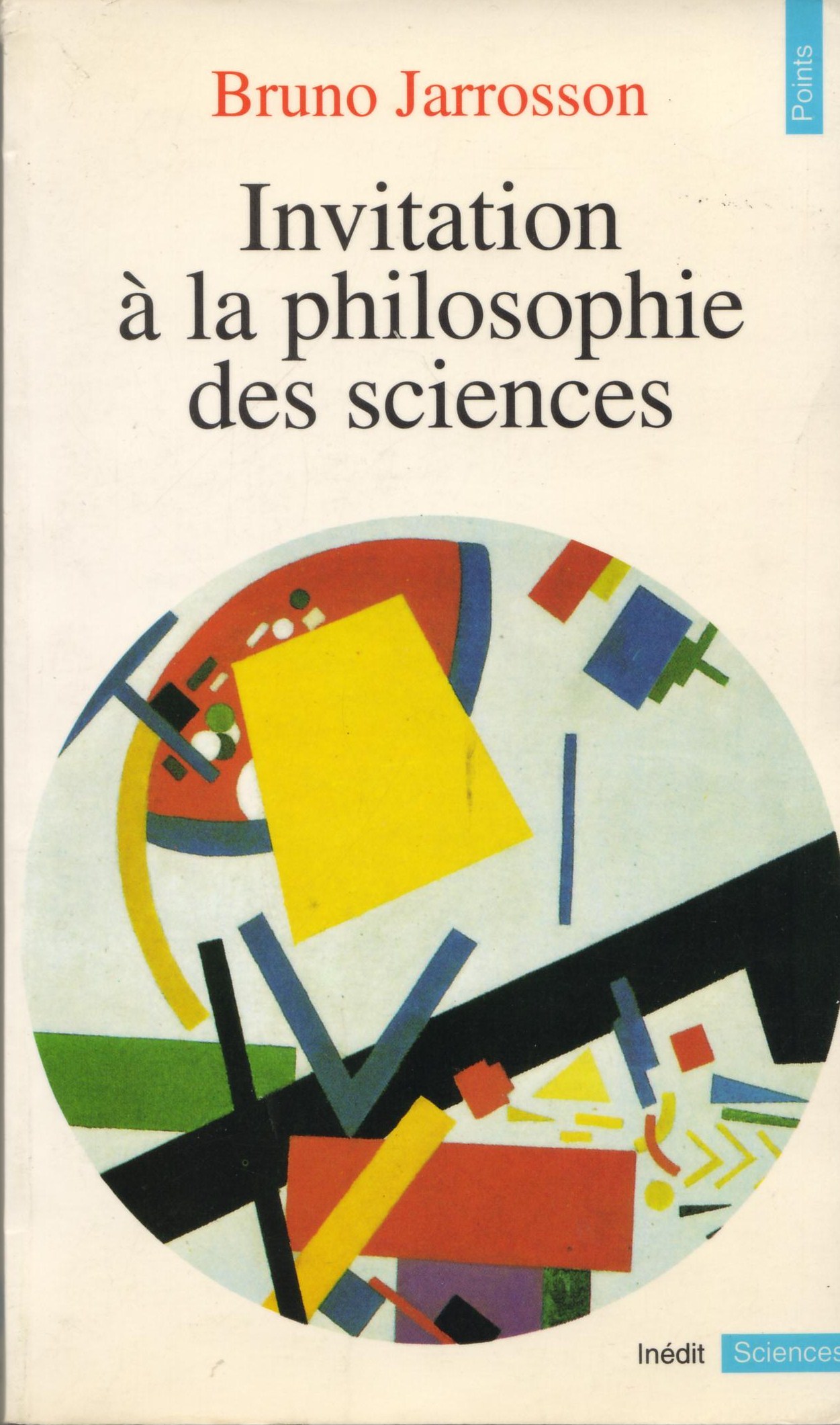Le quatuor des épistémologues
La science est-elle vraie ? La réponse positive semble aller de soi. Pourtant, sous la pression des faits eux-mêmes, les philosophes n’ont pu sauver la validité de la démarche scientifique qu’au prix d’une réflexion nuancée sur l’élaboration des théories. Quatre penseurs ont marqué cette réflexion au xxe siècle : Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos et Paul Feyerabend.
La science a mis le monde en équations. C’est du moins ce que l’on a cru pendant deux siècles. Cet exploit est dû à Isaac Newton et date de 1687 avec la publication des Principia mathematica. Dans ce livre, le savant anglais propose un modèle mathématique qui permet de déterminer par le calcul les mouvements passés et à venir des objets célestes et terrestres.
Au cours des xviiie et xixe siècles, la théorie de Newton sera tenue pour une vérité définitive et indépassable que les faits corroborent excellemment. Marcelin Berthelot, ministre de l’Instruction publique, écrit dans les années 1880 que « le monde est aujourd’hui sans mystère ». Paix à ses mânes qui hantent le Panthéon.
La physique newtonienne prévoit une rotation du périhélie des planètes (le périhélie d’une planète est le point de son orbite où elle se trouve le plus proche du Soleil). Or il se trouve que la rotation observée du périhélie de la planète Mercure ne correspond pas exactement à la théorie. Ce phénomène ne peut être expliqué par la physique newtonienne. Ce sera l’un des grands succès de la relativité einsteinienne de rendre compte de l’orbite de Mercure. La théorie de la relativité dépasse et réfute la physique newtonienne qui ne peut plus être considérée comme une vérité indiscutable. La révolution scientifique de la relativité vient bousculer la vision traditionnelle de la science.
Comment a-t-on pu croire vraie pendant deux siècles la théorie de newtonienne qui finalement ne l’était pas ? Tout simplement parce qu’elle était remarquablement confirmée par l’expérience. Mais une confirmation expérimentale, si elle constitue une intéressante présomption de véracité pour une théorie, ne peut jamais être érigée en preuve.
À proprement parler, la physique newtonienne n’a jamais été prouvée. Le philosophe anglais d’origine autrichienne Karl Popper (1902 – 1994) remarque que la science ne peut se prétendre vraie si elle procède par affirmations. En effet, une expérience dont le résultat est celui prévu par une théorie ne prouve pas l’exactitude de ladite théorie, elle se contente de ne pas la réfuter. Le fait de n’avoir jamais observé un cygne qui ne soit pas blanc ne prouve pas la véracité de l’affirmation « tous les cygnes sont blancs ». Par contre, un seul cygne noir suffit à la réfuter. Les certitudes de la science ne peuvent donc porter que sur les réfutations.
La science est donc faite de conjectures, d’hypothèses que l’on ne tente pas seulement de confirmer mais aussi de réfuter (cf. Karl Popper : Conjectures et Réfutations, Payot, 1985). La science n’est pas vraie, mais seulement conjecturale. Popper définit le critère de réfutabilité comme la ligne de partage entre les disciplines scientifiques et le reste. Une théorie est scientifique si on peut essayer de la réfuter, si elle joue son existence sur une expérience. Si la comète de Halley revient à la date prévue, la conjecture newtonienne n’est pas réfutée. Sinon elle l’est.
Mais en donnant un tel poids à la réfutation, Popper ne commet-il pas une faute logique ? Toute réfutation s’appuie, en effet, sur une mesure dont on admet la validité. Considérer une mesure comme valable, c’est supposer que les instruments de mesure ont fonctionné comme d’habitude et, par conséquent, tenir pour vraie la science de son temps. S’il n’existe pas de certitude mais seulement des conjectures, il est logiquement contradictoire de tenir les réfutations pour certaines. Tous les cygnes ne sont pas blancs, ainsi que le prouve la photo d’un cygne noir. Sauf si la photo ou le cygne sont des faux. D’où cette question : les faits sont-ils vrais ?
Karl Popper : « Seul a un caractère scientifique ce qui peut être réfuté. Ce qui n’est pas réfutable relève de la magie ou de la mystique. »
Si la Terre tourne autour du Soleil, les positions relatives des étoiles fixes devraient changer car nous les regardons à partir de points de vue différents. C’est le phénomène bien connu de la parallaxe qui explique, par exemple, que deux observateurs ne lisent pas tout à fait la même heure sur une pendule à aiguilles pour peu qu’ils l’observent de points différents. Copernic admet que la théorie héliocentrique qui situe le Soleil au centre de l’univers implique une parallaxe saisonnière de la positions des étoiles les unes par rapport aux autres. Entre l’été et l’hiver, la Terre a bougé, notre vision du ciel devrait donc se modifier. Pourtant, cet effet de parallaxe resta inobservable aux xvie et xviie siècles. On ne manqua donc pas d’opposer cette réfutation à Galilée. À tort, car c’est la distance très grande des étoiles qui rendait cette parallaxe inobservable à l’époque. L’objection ne réfutait donc pas l’héliocentrisme lui-même mais seulement la distance supposée des étoiles.
On a souvent reproché à Karl Popper de décrire la démarche scientifique telle qu’elle devrait être et non pas telle qu’elle est. Ainsi que l’ont remarqué de nombreux historiens, les grandes théories scientifiques qui se sont imposées ont toutes été d’abord réfutées par les faits.
La séparation entre théorie et fait, que Popper admet sans discussion, n’est pas aussi nette qu’il y paraît. Un fait contient toujours, implicitement, de multiples théories. Aussi la réfutation ne porte-t-elle pas forcément sur la conjecture nouvelle. Elle peut réfuter une des théories implicites contenues dans le fait. L’exemple de Copernic butant sur le problème de la parallaxe éclaire ce point.
Karl Popper est un philosophe qui croit aux faits avec une confiance totale. Malheureusement, toute perception donc toute observation est liée à une intention. Il n’y a pas de fait en soi, mais des faits observés.
Le scientifique et historien des sciences Thomas Kuhn (1922 – 1996) ne croit pas au schéma poppérien selon lequel la science procède par conjectures et réfutations. Selon lui, ce schéma ne correspond pas à l’histoire des sciences, seule à même de valider toute conception de la science. Dans son livre : La Structure des révolutions scientifiques (Flammarion, 1983), Thomas Kuhn ne prétend pas décrire la science telle qu’elle devrait être. Il veut la montrer telle qu’elle est.
Quand une théorie est réfutée par les faits, les scientifiques ne l’abandonnent généralement pas pour autant. Comme le dit un jour Einstein, à qui l’on demandait ce qu’il aurait pensé si les mesures avaient réfuté la relativité : « Eh bien, j’aurais regretté pour le bon Dieu. La théorie est correcte. » Chaque scientifique met dans sa théorie un cœur irréfutable – irréfutable par décision méthodologique – que Thomas Kuhn appelle paradigme. Les scientifiques croient à leurs théories d’abord et avant tout parce qu’ils croient à un paradigme. Ensuite, ils essaient d’interpréter les faits dans le cadre de ce paradigme. Par exemple, l’anomalie du périhélie de Mercure dans le cadre de la physique newtonienne n’a pas été considérée comme une réfutation de cette théorie. On a supposé qu’il existait entre Mercure et le Soleil une planète qui perturbait l’orbite de Mercure. On a même calculé l’orbite de cette planète supposée, mais elle n’était pas au rendez-vous.
Thomas Kuhn : « Toute théorie scientifique contient un cœur que l’on ne peut remettre en question sans renoncer à la théorie elle-même. »
Le paradigme détermine l’interprétation d’un phénomène. Dans le paradigme d’Aristote, il n’y a pas de mouvement sans cause. Par ailleurs, la cause et l’effet sont simultanés. Donc, quand une flèche suit sa trajectoire, c’est qu’elle est poussée par une force à chaque instant. On en conclut, dans le paradigme aristotélicien, que l’air pousse la flèche à chaque instant. Dans le paradigme newtonien, cette gymnastique intellectuelle est inutile puisque les mouvements peuvent se perpétuer d’eux-mêmes, indépendamment de toute cause. Par ailleurs, la cause et l’effet peuvent être dissociés dans le temps. Donc, la flèche avance parce qu’elle poursuit un mouvement acquis tant qu’elle n’est pas freinée. Dans le premier paradigme, le problème est de rendre compte de l’existence du mouvement, dans le second de l’arrêt du mouvement. Du paradigme dépend l’interprétation du phénomène et la question même que l’on se pose à son sujet.
Les civilisations précolombiennes et chinoise ont observé la supernova du 4 juillet 1054 dans la nébuleuse du Crabe sur laquelle l’Europe n’a laissé aucun témoignage. Le paradigme aristotélicien posait qu’aucun changement ne pouvait avoir lieu dans le monde supralunaire considéré comme immuable. Certains changements, comme cette supernova de 1054, n’ont pas, semble-t-il, été jugés suffisamment importants pour être notés. Les changements dans les cieux ont commencé à être enregistrés et discutés par les astronomes occidentaux après la publication de la théorie de Copernic. Le paradigme dans lequel on travaille influence la perception de la nature.
Kuhn part d’une constatation historique. Lorsqu’un paradigme est dominant, comme le fut par exemple le paradigme newtonien pendant deux siècles en mécanique, il n’est pas réfutable. Les faits qui contredisent le paradigme ne sont pas considérés comme des réfutations mais comme des anomalies. La réfutabilité de Karl Popper ne rend donc pas compte de l’histoire des sciences.
Toute perception est liée à une intention. De même, toute mesure, tout fait est lié à un paradigme. Cela explique, pour Thomas Kuhn, qu’au moment où un nouveau paradigme concurrence un ancien, la discussion ne se situe pas seulement au niveau des réfutations et des faits mais aussi au niveau de la croyance en un paradigme. Thomas Kuhn montre que la plupart des tenants de l’ancien paradigme ne changent pas d’avis, quelles que soient les « preuves » expérimentales. Cette résistance à l’évolution ne procède pas d’un refus sénile de reconnaître les preuves. Simplement, les preuves n’ont force de preuve qu’associées au nouveau paradigme. Dans l’ancien paradigme, elles ne sont pas lisibles. C’est pourquoi la science ne peut pas avancer seulement de façon progressive, mais aussi par ruptures. La science avance aussi parce que les vieux scientifiques qui défendent les anciennes idées meurent avant les jeunes scientifiques qui défendent les nouvelles idées. La relativité n’a pas fait que des conversions parmi les scientifiques plus âgés qu’Einstein. Mais ses adversaires sont morts les premiers.
Thomas Kuhn a commis un péché mortel en parlant de la sociologie de la science. Il se donne l’apparence de mettre la vérité scientifique aux voix (les voix des scientifiques il est vrai), la faisant choir de son piédestal objectif.
L’épistémologue hongrois Imre Lakatos (1923 – 1974), sensible comme Thomas Kuhn aux objections que l’on peut opposer au schéma conjecture et réfutation de Karl Popper, reproche cependant à Kuhn d’accorder trop d’importance aux conditions sociologiques dans lesquelles la science s’élabore. La science vraie serait définie, si l’on suit bien Thomas Kuhn, par ce que croient les grands chercheurs et les grands professeurs d’une époque. Cette façon de dire que la vérité émane de la majorité choque Lakatos qui propose une démarche moins relativiste.
Imre Lakatos : « En science, on trouve d’abord et on cherche ensuite. Il n’y a pas de fait en soi mais des faits observés. »
Quand Galilée fait rouler des billes sur un plan incliné pour découvrir la loi de la chute des corps, il est clair qu’il n’entreprend pas cette expérimentation sans idée préconçue. Il sait d’emblée qu’il doit mesurer les distances parcourues en fonction du temps. L’idée précède l’expérience. Lakatos appelle structure cette idée centrale, ce noyau dur de la théorie.
La structure de pensée est si importante dans l’élaboration de l’expérience qu’elle aboutit même à des expériences par la pensée, des expériences imaginaires et parfois irréalisables. Einstein conçoit la relativité en se demandant comment il verrait un rayon lumineux s’il voyageait à côté de lui à la vitesse de la lumière. Galilée, le père de la méthode expérimentale, explique qu’une boule lâchée du haut du mât d’un navire qui avance tombe au pied du mât et non pas à l’arrière du bateau. Voici ce qu’il écrit, dans son Dialogue sur les deux principaux systèmes du monde, à propos de cette formulation expérimentale du principe de l’inertie : « Et moi, sans expérience, je suis sûr que l’effet s’ensuivra comme je vous le dis, puisqu’il est nécessaire qu’il s’ensuive. » Galilée n’a pas fait l’expérience sur laquelle il fonde sa démonstration. L’expérience par la pensée a pour lui force de preuve. La structure prime sur le fait.
La première réaction face à un noyau dur n’est pas de se demander s’il est vrai ou faux mais ce que l’on peut en faire. Peut-on, à partir de ce noyau dur, établir un programme de recherche fructueux ? La loi de l’attraction universelle est-elle vraie ? Telle n’est pas la première question à se poser au sujet de cette loi mais plutôt : quel programme de recherche puis-je en déduire ? La science est d’abord et avant tout une quête inachevée (cf. le livre de Karl Popper : La Quête inachevée, Calmann-Lévy, 1981).
Contrairement aux paradigmes, les noyaux durs ne s’excluent pas les uns les autres, car plusieurs programmes de recherche concurrents peuvent exister en même temps. Mais tout comme le paradigme, le noyau dur subit l’assaut d’anomalies. Lakatos parle dans son livre Preuves et Réfutations, Essai sur la logique de la découverte mathématique (Hermann, 1984), d’anneau protecteur : on ajoute des hypothèses qui permettent de protéger le noyau dur. Par exemple, on suppose une nouvelle planète pour expliquer les anomalies de l’orbite d’Uranus. Ainsi, Urbain Le Verrier découvre Neptune en 1846. L’anneau protecteur a rempli son rôle.
La démarche de Lakatos est assez proche de celle de Kuhn. Mais là où Kuhn voit une concurrence, parfois féroce, entre paradigmes, Lakatos propose des programmes de recherche entre lesquels la confrontation n’est pas inévitable.
La vision de Lakatos peut paraître angélique. Les scientifiques sont inévitablement tentés d’évaluer et de comparer les différents programmes de recherche car il entre dans leur idéal de prétendre à une certaine forme de vérité.
Une critique plus radicale de la nature de la science est venue du philosophe américain d’origine allemande Paul Feyerabend (1924 – 1994) avec son livre au titre évocateur et provocateur : Contre la méthode, Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance (Le Seuil, 1979).
Paul Feyerabend : « L’idée que la science peut et doit être organisée selon des règles à la fois fixes et universelles est utopique et pernicieuse. »
Feyerabend constate que le développement de la science doit se faire par un apport créatif et que la créativité ne fait pas bon ménage avec la méthodologie. Comment une méthode unique, normative, telle que la pose Popper par exemple, pourrait-elle nous conduire à tous les coups au résultat ? Pour voir dans le monde ce que personne n’y a encore vu, comme le font tous les génies, il faut justement savoir se rebeller contre les méthodes usuelles. Pour Feyerabend, l’idée que la science peut et doit être organisée selon des règles fixes et universelles est à la fois utopique et pernicieuse.
Feyerabend en déduit l’aphorisme à quoi souvent l’on résume sa pensée : « Tout est bon. » Caricature qui laisse penser que pour Feyerabend toutes les théories sont bonnes. Il ne s’agit naturellement pas de cela, mais seulement d’affirmer que toutes les méthodes sont bonnes pour arriver au bon résultat.
Feyerabend s’en prend aux méthodologies censées fournir des règles de conduite aux scientifiques. Il reconnaît en Lakatos un frère en anarchie, puisque Lakatos ne propose pas de critère de choix entre différents programmes de recherche.
La notion de hasard figure en bonne place dans les débats scientifique du xxe siècle. Le hasard est-il une composante intrinsèque de la nature ou le simple reflet de notre ignorance sur les mécanismes véritables de la nature ? Il est difficile de comparer d’un point de vue logique les différentes interprétations des théories qui découlent de ces deux hypothèses dans la mesure où elles s’appuient sur des concepts philosophiques différents. Dès lors, nous dit Feyerabend, les théories concurrentes ne peuvent pas être comparées dans leurs structures logiques, elles correspondent à deux visions du monde différentes.
Cependant, si les théories concurrentes correspondent à des visions du monde différentes, il est néanmoins présomptueux d’en conclure qu’elles ne sont pas comparables. Elles peuvent, en effet, être mises en concurrence au niveau des faits, indépendamment de leur cohérence logique propre. C’est d’ailleurs ce qui s’est souvent passé. On n’imagine pas que la théorie de la relativité se serait imposée si les mesures ne l’avaient pas confirmée contre la mécanique classique. Même si l’on a critiqué plus haut le crédit trop grand que Popper accorde aux faits, on ne peut, d’un revers de main, balayer le fait hors de la science. Aussi ne peut-on suivre Feyerabend lorsqu’il prétend que le choix entre des théories incommensurables est subjectif. Les théories plongent toujours quelques racines dans les faits, dans les mesures ; il existe à ce niveau une zone de rencontre qui permet de les comparer.
Au xxe siècle, le chaos et le hasard ont fait irruption dans la science. La philosophie des sciences a dû s’affirmer pour accompagner cette évolution sans se trouver elle-même rejetée dans ce chaos. On ne sait pas si la science est vraie, mais on peut affirmer tout de même qu’elle s’appuie sur des faits et sur des idées, sur des expériences et sur des paradigmes. On doit également renoncer à démontrer la primauté du fait sur l’idée ou de l’idée sur le fait. L’époque n’est plus aux philosophies fermées mais aux idées complexes, ouvertes, comme aurait dit Gaston Bachelard. Les faits et les idées s’influencent réciproquement, avancent ensemble, cahin-caha. Ainsi marche la connaissance d’un pas d’écrevisse vers un but indéfini.
Science et Avenir, N° 549, novembre 1992