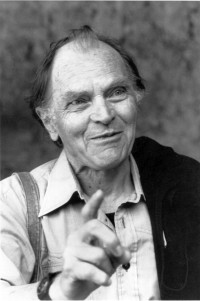La création comme erreur
L’erreur en physique
Les erreurs des grands physiciens sont si nombreuses qu’il n’est pas difficile d’illustrer ce thème. Nous n’évoquerons que trois exemples classiques qui présentent en outre l’intérêt de s’additionner aujourd’hui à de multiples erreurs historiques.
L’astronomie
Les grands astronomes ont pataugé dans l’erreur avec frénésie. Reprenons les étapes.
Ptolémée (90 – 168) opère la synthèse des acquis précédents en voulant donner une représentation mathématique du mouvement des planètes à partir de sphères solides tournant sur d’autres sphères solides elles-mêmes en mouvement. L’hypothèse des sphères solides est si loin de la réalité que pour faire correspondre la théorie aux observations (elles-mêmes fausses, d’ailleurs), Ptolémée en vient à supposer que ces sphères solides qui portent les planètes ne sont pas en rotation par rapport à leur centre mais par rapport à un autre point. Ce qui pour une sphère solide relève d’une sorte de miracle. Cette supposition détruit l’interprétation physique et matérielle qui fonde la théorie de Ptolémée, à savoir que les planètes sont mues par des sphères solides réelles. Sans cette interprétation physique, la théorie devient un calcul compliqué qui ne fait en rien progresser la compréhension du monde.
Autrement dit, au terme de son parcours, l’astronomie grecque et alexandrine se détruit elle-même. Elle renonce en route à ce qui avait constitué sa raison d’être. Cette erreur qui confine au suicide logique ne l’empêchera pas de survivre en tant que théorie dominante pendant une quinzaine de siècles.
La suite ne vaut guère mieux. Copernic (1473 – 1543) veut se débarrasser de cette théorie compliquée en plaçant le Soleil au centre de la création. Louable intuition. Mais il commet une erreur majeure en supposant que les orbites des planètes sont circulaires puisque lui aussi croit aux sphères solides. Comme les sphères solides n’existent pas et que les orbites ne sont pas circulaires, Copernic en vient à supposer que le Soleil n’est pas au centre des orbites, donc à ajouter des centres d’orbite tournant sur des cercles, construisant une astronomie aussi fausse et compliquée que celle de Ptolémée. Fondée sur une intuition qui rapproche du but, l’astronomie de Copernic est fausse, si fausse que son auteur se refusera longtemps à la publier. Galilée (1564 – 1642) patauge lui aussi dans l’erreur en défendant l’astronomie de Copernic sans tenir compte des apports de Kepler (1571 – 1630) qui pourtant la rendent caduque.
Kepler enfin donne une image à peu près correcte du système solaire avec les trois lois qui portent son nom, au terme d’une vie de travail, d’errances nombreuses et d’erreurs de calculs non moins nombreuses. Avant Kepler, il ne s’est pratiquement rien dit de juste en astronomie. À partir de lui, une vision cohérente émerge qui se poursuit dans la synthèse actuelle avec la théorie de la relativité et le big bang.
Erreur à un autre niveau, dans la vulgate historique, Galilée passe pour un grand astronome et Kepler pour un second couteau. Kepler fut pourtant un authentique pionnier et Galilée un polémiste ignorant (en astronomie) qui doit sa célébrité dans ce domaine au fait d’avoir été persécuté.
Le problème du mouvement
Le problème du mouvement fut la grande question de la science grecque (cf. Geoffrey E. R. Loyd : Une histoire de la science grecque, Éditions du Seuil, collection « Points », 1993). Comment le mouvement est-il possible si l’être ne peut jamais devenir ce qu’il n’est pas ? Comment le mouvement est-il possible si Achille doit rejoindre une infinité de fois le point où se trouvait la tortue avant de la dépasser ?
Au problème du mouvement, Aristote (- 384, – 322) apporte une réponse intrinsèquement fausse. Non seulement fausse mais invraisemblable. Pour Aristote, le mouvement est produit à chaque instant par une cause qui est une force. La cause et l’effet sont concomitants dans le temps. Dès que cesse la cause, cesse l’effet. Autrement dit, dès que l’objet n’est plus mû par une force, il s’arrête.
Cette conception du mouvement correspond assez bien à ce qui se produit lorsque l’on pousse une lourde charrette sur un chemin caillouteux. Dès que l’on cesse de pousser la charrette, elle s’arrête. Par contre, l’expérience du jet, de la flèche tirée par l’arc, de la pierre lancée en l’air, contredit de toute évidence cette physique.
Cette erreur initiale d’Aristote va en entraîner d’autres. Pendant près de deux mille ans, les philosophes vont rivaliser d’imagination pour rendre compte de l’expérience du jet dans le cadre de la physique aristotélicienne. L’air pousse la flèche à chaque instant, répondent les aristotéliciens à la question du jet. En effet, si la flèche avance, c’est qu’elle est poussée à chaque instant. Elle ne peut l’être que par ce avec quoi elle est en contact, à savoir son milieu. L’erreur engendre l’erreur. Elle colore aussi les lueurs de vérité. Quand, à la fin du Moyen Âge, les physiciens de l’école de Paris et quelques Italiens s’efforcent de construire une théorie du mouvement plus conforme à la réalité, la théorie dite de l’impetus, ils restent ligotés par les conceptions aristotéliciennes. La théorie juste du mouvement mettra presque cinq siècles à émerger (cf. Alexandre Koyré : Études d’histoire de la pensée scientifique, Gallimard, 1973).
L’autre conséquence négative de ce que l’on peut appeler l’erreur d’Aristote est d’avoir bloqué toute l’évolution de l’astronomie. La nécessité d’une force concomitante à tout mouvement interdit d’admettre que la Terre soit mobile. Car si la Terre se mouvait, les nuages et les oiseaux qui ne sont pas en contact avec elle ne la suivraient pas dans son mouvement. La physique d’Aristote implique donc nécessairement l’immobilité de la Terre. Ce qui ne va pas aider les astronomes dans leur travail. L’erreur dans un domaine bloque l’émergence de la vérité dans un autre.
Galilée (1564 – 1642) va sortir le problème du mouvement de l’erreur, en se trompant plus ou moins du reste. Il dit que les mouvements naturels, sans force, sont le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement circulaire. Bien entendu, seul le mouvement rectiligne uniforme est dans ce cas. Ses considérations sur la loi de la chute des corps, bien qu’aboutissant à un résultat correct, sont entachées d’erreur. Galilée suppose que la vitesse d’un objet en chute libre augmente proportionnellement à la distance parcourue ou au temps du parcours. Mais laquelle des deux hypothèses retenir ? Galilée raisonne et démontre que si la vitesse augmentait proportionnellement à la distance parcourue, alors la chute durerait un temps nul. Ce qui est absurde. Il choisit donc avec raison la seconde hypothèse : la vitesse est proportionnelle au temps du parcours.
Le seul problème, c’est que le raisonnement de Galilée est faux. Si la vitesse était proportionnelle au chemin parcouru, la loi de la chute des corps serait certes différente, mais la chute ne serait nullement instantanée.
L’achèvement de la physique
Une erreur courante des scientifiques est de se méprendre sur la portée et les développements futurs de leur science. Ils se croient généralement beaucoup plus près du but qu’ils ne le sont en réalité. Ce faisant, ils sous-estiment la complexité du monde qu’ils étudient. Cette erreur est d’un type moderne, elle suppose une idée de l’achèvement de la physique qui n’apparaît qu’au xviiie siècle, avec le succès de la physique newtonienne. Pierre Simon Laplace (1749 – 1827), en nous présentant un monde corpusculaire et déterministe strictement gouverné par la force de gravitation, a bien en vue l’achèvement de la physique sous l’égide d’une force unique. Il s’exprime avec prudence mais certains phénomènes connus à son époque, par exemple le phénomène optique des interférences, aurait dû néanmoins lui indiquer la vanité de cette conception du monde.
En 1900, sir William Thomson alias lord Kelvin (1824 – 1907) déclare devant l’Académie Royale des Sciences : « La science forme aujourd’hui un ensemble parfaitement harmonieux, un ensemble pratiquement achevé. » Il concède cependant que deux petits nuages noirs flottent encore dans ce ciel azuréen : l’expérience de Michelson-Morley et le rayonnement du corps noir. Or ces deux expériences aux résultats inexpliquées trouvent finalement leur place dans le cadre des deux théories qui vont balayer sans tarder le bel ensemble cher à lord Kelvin : la relativité et la physique quantique. La déclaration de lord Kelvin ne pouvait d’ailleurs pas arriver plus mal à propos puisqu’en cette même année 1900, Max Planck (1858 – 1947) introduisit sa fameuse hypothèse des quanta ; torpille par laquelle le navire amiral de lord Kelvin allait sombrer.
Les physiciens quantiques n’échappèrent pas à cette illusion d’être rendu au port. En 1928, le physicien Max Born (1882 – 1970) assurait que la physique serait achevée dans les six mois. On avait découvert que la matière était constituée d’électrons et de protons. On allait donc formuler une théorie complète de la matière à partir de ces deux particules. On attend toujours la dite théorie.
Le physicien britannique Stephen Hawking (né en 1942) nous la promettait pour bientôt. En 1980, il estimait à une chance sur deux la probabilité que cette unification soit faite dans les vingt ans, soit en l’an 2000. En 1992, il estime encore qu’il y a une chance sur deux qu’elle soit faite dans les vingt ans, soit en… 2012. Demain, on rase gratis. « Honni soit qui mal y pense. »
Caramba, encore raté.
Cependant, on ne saurait s’en tenir à une vision exclusivement négative de ces erreurs. Dans la mesure où elles constituent l’histoire de la science, elles forment la marche vers la vérité. Comme pour l’apprentissage des mathématiques, c’est en se penchant sur l’erreur que la science progresse. C’est à partir du constat qu’Aristote s’est trompé que de nouvelles idées sont proposées. Dans une perspective dynamique de recherche, mieux vaut une théorie fausse que pas de théorie. Car de la théorie fausse, au moins, l’on peut discuter. Ainsi il semble qu’aujourd’hui l’évolution de la physique quantique ne soit pas stimulée par des anomalies et des cas où la théorie ne fonctionne pas. La théorie marche toujours, elle marche trop bien. Aucun nuage noir ne peut servir d’appui pour monter au ciel.
L’erreur en mathématique
« On peut et on doit même négliger de réfuter les erreurs de certains particuliers sans nom et sans réputation, parce que leurs erreurs ne sont d’aucune conséquence pour le Public. Mais celles des grands hommes doivent être remarquées avec soin, quoiqu’avec le respect et le ménagement qui leur sont dus, de peur que leur autorité n’impose, et ne l’emporte sur la vérité. »
François de Lagny, Journal des Sçavans pour 1693
Les erreurs des grands mathématiciens constituent un témoignage éloquent des origines douteuses de la vérité. Nous ne nous intéresserons pas, bien sûr, aux erreurs de calcul mais seulement aux erreurs de raisonnement.
Une des erreurs les plus célèbres est celle de Pierre de Fermat (1601 – 1665), mathématicien original et scrupuleux homme de loi, qui écrit dans la marge de son exemplaire des mathématiques de Diophante : « J’ai démontré que la relation xn + yn = zn est impossible pour les nombres entiers (x, y, z différents de zéro ; n supérieur à 2). Mais la marge ne me laisse pas assez de place pour inscrire la démonstration. » La démonstration de cette propriété va ainsi devenir pour longtemps le problème le plus célèbre des mathématiques. La propriété est vraie, elle sera démontrée en 1993 par le jeune mathématicien anglais Andrew Wiles (né en 1952). Le 23 juin 1993 à Cambridge, à l’issue de trois jours d’exposé et d’« astuces diaboliques », Wiles arrive au terme de sa démonstration, suscitant bien entendu un vif émoi. Mais la démonstration était absolument inaccessible à Fermat. Fermat ne l’avait pas trouvée, contrairement à ce qu’il croyait. Un point sur lequel il ne s’est pas trompé, c’est que la démonstration ne tenait pas dans la marge de son exemplaire de Diophante.
Le suisse Leonhard Euler (1707 – 1783) commettra, à propos de ce théorème, une de ses plus belles erreurs puisqu’il en donnera une démonstration fausse pour n = 3. La démonstration est certes inexacte mais elle contient l’intuition qui conduira plus tard à la bonne démonstration (toujours pour n = 3). Erreur positive, donc.
D’autres erreurs moins graves de grands mathématiciens : Leonhard Euler, encore lui, commit quelques erreurs dans son catalogue de nombres premiers. Il oublie 1 000 009. Il indique comme nombre premier 1 000 169, nombre qui vaut pourtant 197 x 5 077. Il en donne huit autres faux. Péchés véniels au regard de ce qui suit. Adrien Marie Le Gendre (1752 – 1833) a donné sept démonstrations, toutes fausses évidemment, du cinquième postulat d’Euclide. Il avait pourtant démontré l’incommensurabilité de PI, ce qui aurait pu l’alerter sur les limites possibles de la connaissance. L’incommensurabilité de PI n’arrêta pas André Marie Ampère (1775 – 1836) qui crut résoudre la quadrature du cercle. Ces peccadilles sont généralement passées sous silence par les encyclopédies, les dictionnaires et les histoires des sciences.
Augustin Cauchy (1789 – 1857) qui fit faire à l’analyse des progrès considérables dans la rigueur démontra aussi, en 1812, un théorème d’ailleurs déjà énoncé par Euler concernant les polyèdres : pour tout polyèdre le nombre des faces plus le nombre des sommets est égal au nombre des arêtes plus deux. Hélas ce théorème, « démontré », est faux. Et l’on mit du temps à l’admettre. Dès 1813 pourtant, un certain Lhuilier publia un contre-exemple, qui passa inaperçu. Le théorème ne fut reconnu faux, sous la forme donnée par Euler et Cauchy, qu’en 1832 du fait d’autres contre-exemples. Cet épisode de l’histoire des mathématiques, un des plus surprenants qui soit pour Jacques Hadamard (1865 – 1963), fait l’objet d’un livre entier de l’épistémologue Imre Lakatos (1923 – 1974) : Preuves et Réfutations (Hermann, 1984).
Autre témoignage sur la naïveté de certains scientifiques. Michel Chasles (1793 – 1880), abusé par un habile faussaire, produisit des lettres de Pascal (1623 – 1662) à Robert Boyle (1627 – 1691) qui prouvaient que Pascal avait découvert la gravitation vers 1654, soit trente-trois ans avant Newton (1642 – 1727). De 1867 à 1869, la polémique fait rage. L’Académie des Sciences reconnaît l’authenticité des documents. Un certain Charles Bénard s’étonne : « Comment Pascal aurait-il pu calculer le 2 janvier 1655 la masse de Saturne à l’aide des révolutions d’un satellite découvert le 25 mars suivant ? » Bonne question en effet, merci de l’avoir posée. Chasles, confondu, dut admettre son erreur.
En mathématiques, il est normalement possible de distinguer le vrai du faux. Beaucoup plus sûrement qu’en physique où les mesures sont toujours sujettes à caution. Les mathématiques représentent la science sans mesure, la science théorique pure. Cette propriété n’empêche pas cependant l’erreur de se mêler à son histoire comme à celle de la physique. Le regard négatif que nous posons sur l’erreur garde-t-il sa raison d’être ?
L’erreur positive : Popper et Bachelard
« C’est une maladie naturelle à l’homme de croire qu’il possède la vérité directement ; et de là vient qu’il est toujours disposé à nier tout ce qui lui est incompréhensible ; au lieu qu’en effet il ne connaît naturellement que le mensonge, et qu’il ne doit prendre pour véritables que les choses dont le contraire lui paraît faux. »
Blaise Pascal, De l’esprit de géométrie et de l’art de persuader
En 1934 paraissent La logique de la découverte scientifique (Payot, 1984) de Karl Popper (1902 – 1994) et Le nouvel esprit scientifique (PUF, 1984) de Gaston Bachelard (1884 – 1962). Ces deux livres jettent pour la première fois dans l’histoire de la philosophie des sciences un regard positif sur l’erreur. L’erreur n’est plus l’horreur mais une étape de la démarche scientifique.
Pour Popper, la démarche scientifique consiste à émettre des hypothèses hardies et à tenter de les réfuter par des expériences bien conçues. Plus les hypothèses sont hardies, plus il y a de chances qu’on les réfute en effet par les expériences. La réfutation expérimentale ne doit pas être vécue comme un échec mais tenue pour une étape normale du travail scientifique. La science ne progresse pas de vérités en vérités, pour Popper, mais de conjectures en réfutations. Les théories que nous tenons pour vraies ne sont que des conjectures non réfutées par les faits. Ce qui ne prouve pas qu’elles ne le seront pas plus tard.
Pour Bachelard également, l’erreur est au cœur de la science. Nous avançons, dit-il, « d’erreurs dissipées en erreurs dissipées ». Nous devons certes chercher à dissiper des erreurs, mais nous ne saurions en déduire que nous sommes dans la vérité et que nous en avons fini avec l’erreur.
Popper et Bachelard ont cherché et réussi à concilier une vision positive de l’erreur et une vision non relative de la science en la rendant plus modeste devant l’idée de vérité. Si l’on ne peut atteindre la vérité, toutes les connaissances ne sont-elles pas relatives ? Non répondent Popper et Bachelard, justement non. Car s’il est impossible d’établir que nos connaissances sont vraies pour toujours, il est des erreurs certaines. La partie non relative de la connaissance, c’est justement l’erreur. Selon un exemple célèbre et rabâché, on ne peut jamais prouver que l’affirmation « tous les cygnes sont blancs » est vraie. Le fait de n’avoir observé que des cygnes blancs ne prouve pas qu’elle est vraie. Par contre, le fait de voir un seul cygne noir suffit à prouver avec certitude qu’elle est fausse. Ce n’est donc pas la vérité qui est certaine, mais l’erreur. Paradoxalement, l’erreur que l’on avait voulu chasser du temple de la connaissance au nom de la certitude est la seule à maintenir cette fameuse certitude et donc à supporter le temple. Bon gré mal gré, il faut bien lui ménager une place dans la maison du père.
La certitude de la science était depuis toujours fondée sur un tour de passe-passe philosophique, à savoir l’induction. On induisait qu’une théorie était vraie à partir d’observations la confirmant. On induisait que tous les cygnes sont blancs du fait que l’on n’a observé que des cygnes blancs. Mais ainsi que l’avait remarqué David Hume (1711 – 1776), une telle démarche est sans valeur méthodologique. De l’accumulation de cas particuliers on ne peut logiquement dériver une loi générale. Autrement dit, toute la solide vérité de la science reposait sur une base exclusivement métaphysique, une simple croyance. Pour David Hume, il faut admettre l’induction par un acte de foi. « La véritable pensée scientifique est métaphysiquement inductive », écrit Gaston Bachelard. La science n’avait que la métaphysique pour justifier sa méthode traditionnelle. Popper et Bachelard, en donnant une nouvelle place à l’erreur, permettent à l’épistémologie de sortir de cette situation gênante.
Choisir la vie
Ainsi que le souligne Karl Popper, il appartient aux faits de valider ou d’invalider les hypothèses hardies. Le fait est pour la théorie un juge de paix dont les sentences sont des constats d’erreur. Mais cette vision légaliste de la science ne l’épuise pas. La loi n’est pas la réalité. Ainsi que l’a démontré Thomas Kuhn (1922 – 1996) dans son célèbre livre La structure de révolutions scientifiques (Flammarion, 1983), il appartient inversement aux théories de valider les faits. Une théorie peut dire qu’un fait est faux. Cela est arrivé dans l’histoire de la science et a permis son progrès. Ainsi, certaines mesures invalidant la relativité sont-elles tenues pour fausses sans autre forme de procès. Si les scientifiques avaient toujours cru aux faits, ils n’auraient pas pu sortir de certaines impasses. Rappelons que certains faits réfutaient l’idée que la Terre tourne autour du Soleil. La théorie peut contester une mesure parce qu’une mesure peut toujours être entachée d’erreur. Par ailleurs, un fait est toujours interprété et l’interprétation peut introduire une erreur inconsciente.
Les deux pôles entre lesquels oscille la connaissance, faits et théories, sont donc l’un à l’autre des sources d’erreurs. La connaissance oscille entre des erreurs factuelles et des erreurs théoriques.
Connaître est une erreur que seule dépasse celle de ne pas connaître. « Si je me trompe, je suis », écrit saint Augustin. Connaître, c’est se tromper. Mais ne pas connaître, c’est se tromper plus encore.
Une analogie avec la théorie de la décision, dont la connaissance est le fondement, permet de comprendre ce point. Prendre une décision ne se fait jamais avec la certitude de prendre la bonne décision puisque les conséquences lointaines de nos décisions nous sont inconnues. Si je constate, longtemps après ma décision, qu’elle fut bonne – ce qui ne peut être qu’une croyance puisque j’ignore ce qu’aurait donné une décision différente – je dois avouer qu’elle fut bonne par hasard et par de tout autres conséquences que celles que j’avais anticipées. On ne peut jamais prendre consciemment et en parfaite connaissance de cause la bonne décision parce qu’on ne décide jamais en parfaite connaissance de cause. Il n’empêche qu’il vaut souvent mieux décider, et mal décider, que de ne pas décider du tout. Car la décision nous permet de définir notre identité dans le monde. Elle est une modalité de l’être. Ne pas décider, c’est renoncer à être. Le chemin se fait en cheminant, la vie en décidant.
Il en va de même avec la connaissance. Elle est une modalité de l’être. Il vaut mieux se tromper et cheminer d’erreurs en erreurs que de n’avoir aucune idée. Être dans l’erreur signifie étymologiquement errer. Il vaut mieux errer pour connaître et vivre que de rester sur place car la vie est mouvement. Se tromper comme décider, c’est vivre tout simplement.
Descartes (1596 – 1650) lui-même, bien que ferraillant contre l’erreur qu’il exècre, admet qu’un voyageur perdu en forêt doit partir au hasard plutôt que de ne rien faire. Avec ce problème qu’il décrit dans ses Méditations métaphysiques, il aborde la question de la décision en donnant sa place à l’erreur.
L’erreur et la création
L’erreur, sa genèse et la simple possibilité de son existence, nous instruisent sur une face cachée de la création. L’erreur est moins supportée par les faits que ne l’est la vérité. Si elle s’impose, c’est donc qu’elle aura été plus convaincante. Elle part avec un handicap. Elle nous instruit donc sur les critères d’acceptation d’une théorie par la communauté scientifique au-delà de la simple correspondance avec l’expérience. Nous avons aperçu ces critères à travers nos exemples. Résumons ces critères qui favorisent l’erreur :
- Un préjugé difficile à déraciner et fondé sur l’évidence des sens. Exemple : l’immobilité de la Terre.
- Une méthode qui restreint le champ des hypothèses. Exemple : les orbites circulaires.
- La volonté de sauvegarder une métaphysique ou une morale hors du champ scientifique. Exemple : l’affaire Galilée ou plus récemment l’affaire Lyssenko. Rappelons cette histoire : le biologiste soviétique Trofim Lyssenko (1898 – 1976) imposa, avec l’appui de Staline, la génétique prolétarienne contre la génétique bourgeoise. De 1940 à 1965, l’URSS professa et utilisa une génétique fausse et absurde pour des raisons politiques. Ce qui eut entre autres des conséquences catastrophiques sur l’agriculture. De nombreux scientifiques attachés à la vérité eurent l’occasion d’en parler aux cailloux des goulags sibériens. Lyssenko, désavoué sur le tard après avoir été comblé d’honneurs, termina courageusement ses jours dans son lit tandis que des centaines de ses victimes abusaient de l’hospitalité paradisiaque des camps sibériens.
- L’absence d’un concept théorique nécessaire. La difficulté de définir la vitesse instantanée bloque l’évolution de la dynamique.
- L’absence de vérification. L’autorité d’un maître incontesté entraîne tout le monde dans l’erreur. On admet le théorème sur les polyèdres parce que c’est Augustin Cauchy lui-même et en personne qui l’énonce.
- La sidération. La physique newtonienne, avec l’hypothèse de la gravitation universelle, est tellement sidérante de simplicité que ce n’est que dans la moitié du xixe siècle que l’on perçoit les difficultés qu’elle pose et que l’on ouvre la voie à la relativité.
Au-delà de ces marques de fabrique de l’erreur, notons qu’elle manifeste l’autonomie du discours, la liberté du récit. Si le discours sur le monde a la possibilité de dire ce qui n’est pas, c’est qu’il est libre. Ainsi l’erreur manifeste la liberté du sujet dans le monde. Liberté qui s’étend à la création scientifique.
Si nous évoluons « d’erreurs dissipées en erreurs dissipées », ainsi qu’on l’a dit, l’erreur est donc la brique dont l’édifice de la science est construit. Certes, il faut dissiper l’erreur et donc, de ce point de vue, la qualifier d’horreur. Mais par ailleurs, le scientifique devra accueillir l’erreur qui remplacera l’erreur. La théorie de la relativité restreinte fait figure d’erreur au regard de la relativité générale. Mais erreur moindre que la relativité galiléenne qu’elle remplace. Si, en 1905, Einstein n’avait pas été accueillant à l’erreur de la relativité restreinte, s’il avait vu trop vite les paradoxes qu’elle contenait, il se serait peut-être découragé en chemin et n’aurait pas été jusqu’à la relativité générale. Tel est le paradoxe que pose l’erreur à chaque étape de la science : la chasser pour mieux l’accueillir ou l’accueillir pour mieux la chasser.