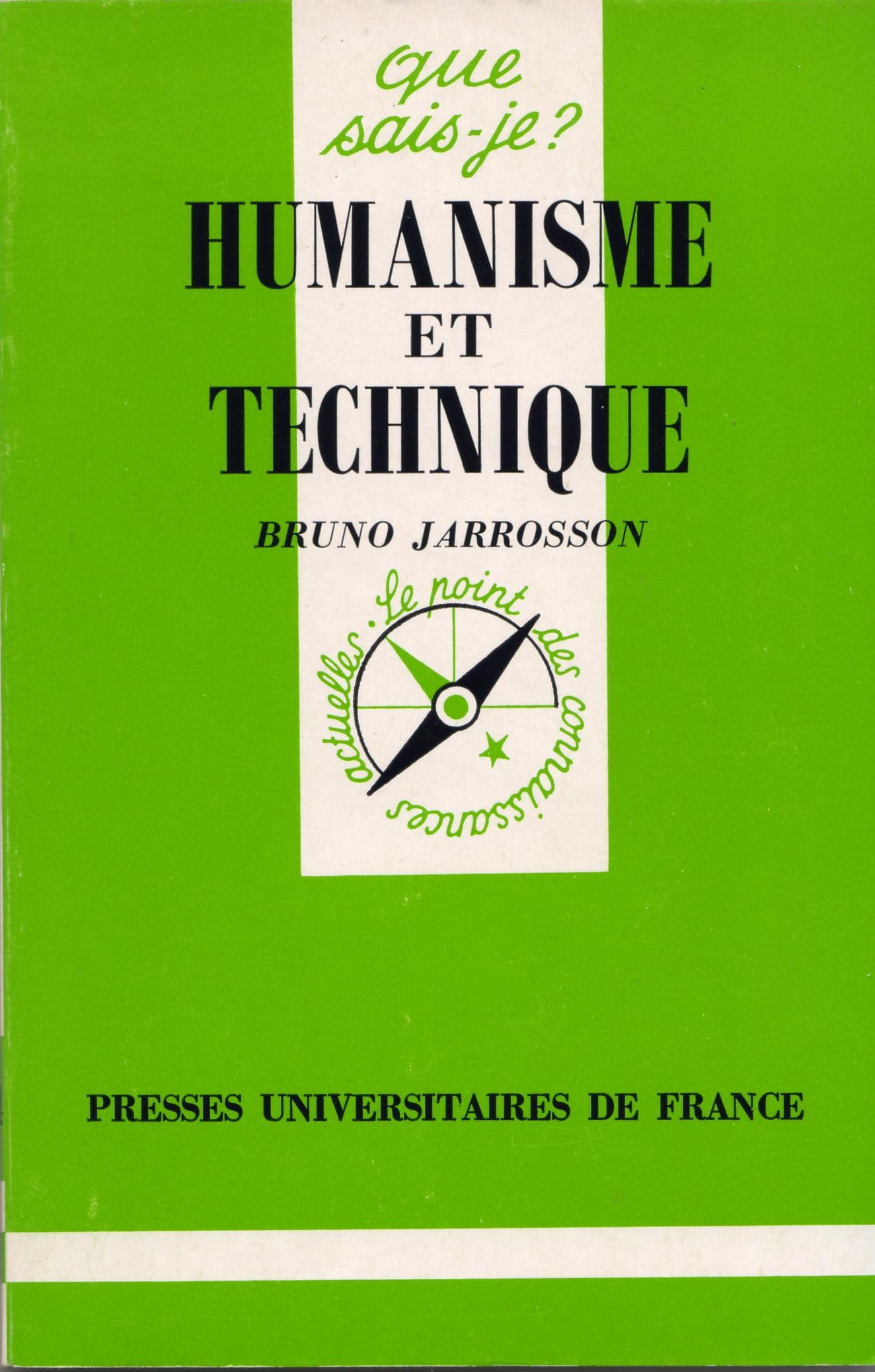Clausewitz ou la fausse modernité
« J’écrirai jusqu’à ce que j’aie quelque chose à écrire. »
Gracchus Cassar
« Quand on y pense, il y a dans le monde plus d’orteils que d’hommes. »
Gracchus Cassar
Clausewitz en son temps
Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780 – 1831) était un officier prussien qui participa aux guerres napoléoniennes. Contre les Français bien sûr. Comme ses compatriotes, il subit le traumatisme de la défaite d’Iéna (13 octobre 1806). Il participe donc de ce que l’on a appelé en Prusse « l’esprit d’Iéna ». Les Prussiens voulaient comprendre comment et pourquoi les Français avaient pu leur infliger une telle humiliation et en déduire un programme de réformes pour à leur tour battre ces maudits Français.
L’esprit d’Iéna aboutit à la victoire sur la France de 1870 – 1871 et à la création de l’Allemagne qui fut signée dans la Galerie des glaces.
Clausewitz est mort prématurément (cinquante-et-un ans) du choléra. Son œuvre De la Guerre est inachevée et posthume. Elle fut publiée par sa veuve après sa mort sans que l’on sache exactement si Clausewitz la destinait à la publication.
Bien que prussien, Clausewitz est le stratège de Napoléon (à égalité avec Jomini tout de même, un Suisse qui aurait pu faire l’objet d’un chapitre dans ce livre), celui qui tire les enseignements stratégiques de la nouvelle façon de faire la guerre inventée par le Corse prodigieux. Les travaux pratiques ont précédé la théorie. Napoléon est un personnage historique hors norme qui, à ce titre, suscite a minima l’intérêt et souvent l’admiration. En particulier en France puisque Napoléon est après tout le dernier Français à avoir donné une bonne déculottée aux Allemands. Mais du point de vue de la géopolitique européenne, Napoléon constitue une catastrophe. Il est responsable de treize années de guerre en Europe, pour un résultat nul. Résultat nul pour la France qu’il laisse plus petite et plus faible qu’il ne l’a trouvée, résultat nul pour l’Europe appauvrie et traumatisée. Cette période renforce l’antagonisme franco-allemand dont on sait maintenant qu’il a fait soixante-dix millions de morts et le malheur de l’Europe de 1870 à 1945. Si l’on quitte l’esprit cocardier, on comprend que Napoléon est surtout une catastrophe pour la France et l’Europe. On voulait l’Europe en mieux et on a eu l’Europe empire.
Point de vue : Clausewitz est à la stratégie ce que Napoléon est à l’Europe : une catastrophe. Avec la même notoriété et le même pouvoir de fascination. La Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale sont des catastrophes absolues dans l’histoire de l’humanité – soixante-dix millions de morts. Des catastrophes absolues et inédites au regard desquelles les malheurs de l’époque napoléonienne ou de la Guerre de Trente ans font pâle figure. Or ces catastrophes sont dans la ligne de la pensée stratégique de Clausewitz. Il ne s’agit pas de dire que Clausewitz est à lui seul la cause de ces malheurs – ce serait lui donner trop de poids dans l’histoire. Mais il a peut-être fait pire en donnant un cadre théorique apparemment raisonnable à une vision du monde qui conduisait à des folies. Il a recouvert d’un voile d’intelligence apparente une vision de la stratégie que l’on pourrait qualifier de stupide. L’emballage est magnifique et le contenu mortel.
On l’aura compris, Clausewitz n’est pas mon chouchou ni ma tasse de thé comme on dit aujourd’hui bien que les conséquences de sa pensée soient plus graves qu’un mauvais thé.
La Grande Guerre et Clausewitz
» Devant ces armées qui s’enterrent en silence
on se retrouve seul. «
Jacques Brel
En janvier 1931, les obsèques de Joffre donnèrent lieu à un hommage républicain aussi fastueux que ridicule. Joffre, le vainqueur de la Marne, avait fait l’objet d’un culte de la personnalité de 1914 à 1916. Il recevait chaque jour des cadeaux sucrés, des lettres d’admiration outrées, etc. Son abyssale incompétence lui a quand même valu d’être démis de sa responsabilité de généralissime – sous la forme d’une promotion tout de même. Et il continua à être honoré comme un grand homme de la République après ces deux années de dictature sans contrôle républicain. Or sous la façade honorable, qu’est-ce que Joffre ? J’offre pas grand-chose à notre admiration.
- Un homme inculte. Il n’avait jamais lu de livre, pas même des livres de stratégie.
- Un homme dénué de conversation. Il ne savait pas créer de débat sur les options stratégiques.
- Un dictateur : il limogeait instantanément tout officier qui exprimait un désaccord avec lui. N’hésitant pas à le faire passer pour incompétent. Surtout si cet officier avait raison, ce qui était souvent le cas quand on était d’un avis opposé à Joffre.
- Un homme qui sans jamais douter a envoyé un million de jeunes Français à une mort aussi certaine qu’inutile. Tout en dormant dix heures par nuit et en prenant de gargantuesques repas de deux heures.
Une époque imprégnée de la pensée de Clausewitz a donné pendant deux ans et demi les clés de la France à un tel homme pour conclure cette absurdité par des obsèques nationales. Une telle étrangeté mérite un retour sur la chute de la pensée stratégique avec Clausewitz.
Cette Grande Guerre est monstrueuse, certes, et la génération qui combat ne peut qu’y voir l’aboutissement de la pensée de Clausewitz ou même de la pensée de Napoléon formalisée par Clausewitz. Ce qui montre la filiation entre Clausewitz et les décideurs de cette époque maudite :
- La guerre est bien la continuation de la politique par d’autres moyens que la politique. Lorsque le 23 juillet 1914, l’empire autrichien envoie un ultimatum inacceptable à la Serbie, il prend délibérément le risque d’une guerre européenne. Cette décision politique résulte d’un calcul de probabilité, c’est un coup de poker, un jeu. Et les dirigeants allemands, russes et français ont jugé que cela pouvait valoir la peine de faire la guerre, qu’il y avait de bonnes chances que leur pays y gagne davantage qu’il y perde. Cette guerre n’est pas seulement due au fait que l’empereur allemand le plus bête de l’histoire s’est trouvé au pouvoir en même temps que l’empereur russe le plus bête de l’histoire. Elle est due aussi à l’ensemble des classes politiques qui considérait la guerre comme une option politique parmi d’autres. De toute façon, ça devait bien finir par arriver, alors un peu plus tôt, un peu plus tard…
- La montée aux extrêmes s’est matérialisée dans le progrès technique. On consommait dans les batailles cent fois plus d’obus que ce que l’on prévoyait avant la guerre. Vingt-cinq millions d’obus sont tombés sur Verdun en 1916 (dont un quart, non éclatés, sont encore dans le sol). Avec une mitrailleuse, un homme pouvait arrêter et tuer des centaines d’assaillants. Les gaz prolongent en ce siècle de technologie la montée aux extrêmes de la technologie contre l’homme. Ce que la bombe atomique parachèvera. Il n’y a pas de limite au développement technique quand il s’agit de détruire cet être fragile qu’est l’homme. C’est facile de tuer un homme avec une bonne technologie. On découvre alors que c’est même très facile d’en tuer des millions. La productivité, maître mot de notre temps, s’est emparée de la guerre par le biais de la technique.
- Avec les attaques massives, les généraux cherchaient à créer un point fort. Malheureusement, les conditions de la technique donnaient l’avantage à la défense. Le point fort n’était jamais assez fort pour emporter la décision de la guerre. Par contre, les préparatifs de l’attaque prévenaient l’adversaire qui se renforçait. Le point fort portait sur le point fort de l’ennemi. Ce qui est certes conforme à la montée aux extrêmes mais contraire à ce que recommande le bon sens et à ce que cherchait à faire Napoléon – le modèle clausewitzien – dont les plus grands succès ont été obtenus quand il a fait porter son point fort sur le point faible de l’adversaire.
- L’approche est directe en ce sens qu’il y a identité entre les buts poursuivis – percer le front – et les moyens mis en œuvre : l’attaque massive. Ainsi chacun sait ce que veut et fait l’adversaire. Les notions de ruse, de tromperie, de dissimulation n’ont pas leur place dans cette guerre faite par des hommes qui ne croient qu’en la force et sont imbus des rapports de forces. Clausewitz n’est pas plus le continuateur de Sun Tzu que Napoléon ne serait celui de Machiavel. Si Napoléon avait compris et mis en œuvre la pensée de Machiavel, il n’aurait pas perdu son empire, c’est certain (on a retrouvé l’exemplaire du Prince que lisait Napoléon avec les commentaires de l’Empereur dans la marge – commentaires critiques, ironiques et imbus d’orgueil, toujours le même péché capital). De même, si Joffre, Nivelle, Pétain, Falkenhayn, Hindenburg, Ludendorff avaient mieux connu et utilisé Sun Tzu que Clausewitz, ils auraient organisé avec moins d’ardeur les stupides massacres dont ils portent la responsabilité.
Quand on a assisté aux premières loges au suicide d’une civilisation, on est fondé à remettre en question la philosophie qui sous-tend ce suicide que l’histoire ne commandait pas mais que des hommes ont voulu et pensé. La Grande Guerre rompt l’idée hégélienne selon laquelle l’histoire a un sens, se dirige vers davantage de paix et de démocratie.
Les notions-clés de Clausewitz
Clausewitz donne une définition de la guerre, qu’il compare à un duel : « La guerre est un acte de violence dont l’objectif est de contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté. » Cette définition est importante parce qu’elle montre que Clausewitz croit – comme Napoléon – que l’on peut contraindre durablement la volonté de l’autre. Machiavel, par exemple, se garde de cette naïve idée. Pour lui, la guerre est un des temps de la négociation. Mais il sait bien qu’après comme avant le combat, l’ennemi gardera sa volonté et ses objectifs. La guerre, ce duel, est donc le point culminant de la relation, celui qui détermine la suite. Alors que pour les hommes des xvie, xviie et xviiie siècles, le point culminant de la relation est la négociation.
Clausewitz pense que Napoléon a obtenu des succès militaires parce qu’il a su modifier les règles du jeu de la guerre. Il entend définir les règles de la guerre moderne, celles qui conduisent au succès. Quelques concepts que Clausewitz extrait du modèle napoléonien :
- Le brouillard de la guerre. Clausewitz remarque qu’il est impossible au chef de savoir exactement ce qui se passe au moment où ça se passe. La guerre réelle n’a qu’un rapport lointain avec la guerre modélisée. Il faut savoir faire la part du hasard.
- La friction. Clausewitz regroupe sous le concept de « friction » tout ce qui s’oppose à l’action de guerre et qui fait que quelque chose de pourtant simple à définir n’est jamais facile à réaliser. Les pannes en cascade, les erreurs, les retards rompent l’harmonie de la stratégie. Et plus la guerre est technique, plus il y aura de frictions. À la guerre encore plus qu’ailleurs se manifeste la résistance de la matière à l’idée. Pour réduire cette friction, Clausewitz préconise l’entraînement intensif et l’élaboration de procédures. On notera que cette idée de friction est un des grands apports de Clausewitz, lié à l’arrivée de la technique dans la guerre. La technique a tendance à mettre ses dispositifs en série si bien qu’une seule panne compromet l’ensemble. Pour qu’une voiture roule, il faut que toutes les pièces fonctionnent. Une seule panne d’une seule pièce parmi mille possibles suffit à mettre la voiture à l’arrêt. La friction vient de là. Une seule panne parmi des milliers possibles suffit à dérégler une opération fondée sur beaucoup de technique.
- Le point décisif ou Clausewitz remarque que Napoléon, à ses débuts, a remporté des victoires tout en étant en infériorité numérique. C’est par exemple le cas à Austerlitz qui représente l’exemple parfait et paradigmatique de la stratégie napoléonienne réussie. C’est qu’il s’agit en fait de se trouver en supériorité au point sur lequel la bataille se décide au moment précis où elle se décide. Dans une bataille, il y a un lieu et un moment décisifs, où les choses se jouent. Il faut distinguer ce lieu et ce moment, y créer la supériorité. L’unité du commandement est donc nécessaire. Napoléon à Austerlitz affronte une coalition et Foch a écrit qu’il admirait moins Napoléon depuis que lui-même commandait – ou plutôt essayait de commander – une coalition. Par ailleurs, les troupes doivent pouvoir manœuvrer plus vite que celles de l’adversaire. Dans la nuit qui précède Austerlitz, Napoléon a déplacé ses troupes, trompant ainsi l’ennemi sur sa position réelle. À l’inverse, c’est l’erreur dans la manœuvre de Grouchy qui a fait perdre la bataille de Waterloo. Sur le point et le moment décisifs, ce fut Blücher qui pesa, comme l’a noté non sans justesse Victor Hugo.
- L’introduction des probabilités dans le raisonnement stratégique. Comme le brouillard de la guerre peut mettre en échec la rationalité de la stratégie, Clausewitz qui croit à la rationalité veut rationaliser le hasard par l’introduction des probabilités. Là aussi il s’inspire de Napoléon qui disait engager une bataille s’il avait au moins 70 % de chances de gagner. Cette rationalisation apparente du hasard est peut-être rassurante en tant que rationalisation. Elle est néanmoins assez discutable pour deux raisons. Tout d’abord, l’évaluation de la probabilité est subjective. Ensuite, une probabilité se définit comme le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le concept de probabilité ne s’applique donc pas à une situation unique par définition. La probabilité en l’occurrence n’est qu’une vue de l’esprit.
Plus généralement, Clausewitz remarque que la France a dominé l’Europe parce qu’elle a mobilisé davantage de ressources pour la guerre et que l’Europe a finalement vaincu la France quand elle a mobilisé les mêmes ressources. De cela il va déduire la plus catastrophique des idées de stratégie : la montée aux extrêmes.
La montée aux extrêmes
» La girouette en deuil criait au firmament ; «
Alfred de Vigny
Clausewitz justifie l’idée que pour soumettre la volonté de l’autre, on mobilise davantage de ressources que lui. Mais dans la guerre, le jeu de l’adversaire est de résister à cette volonté en mobilisant lui aussi des ressources. Il se produit donc une augmentation des ressources consacrées à la guerre à laquelle chacun des adversaires réagit par une mobilisation supplémentaire de ressources. Il se produit alors ce que Clausewitz appelle « la montée aux extrêmes ». Toutes les ressources du pays sont mobilisées dans la guerre. La montée aux extrêmes fait de la guerre une lutte à mort pour la survie, une guerre totale.
Voilà ce que Clausewitz constate et justifie. Le pire étant sans doute que cela nous paraisse banal. Nous nous sommes habitués à l’inacceptable. Pourtant, à la charnière des xviiie et xixe siècles, il se produit un changement profond dans la façon de faire et comprendre la guerre.
Jusqu’au xviiie siècle, les guerres ne mobilisaient qu’une faible partie des ressources des pays. Les armées comptaient quelques milliers d’hommes – au pire quelques dizaines de milliers – et des armements peu sophistiqués. Les victimes ne représentaient qu’une part infime de la population. Le désastre d’Azincourt le 25 octobre 1415 ne fit que 6 000 victimes dans l’armée française, en un seul jour. La bataille de Verdun en 1916 fit 320 000 morts dans l’armée française et dura dix mois. Azincourt est à coup sûr un grand désastre stratégique et politique mais une infime vaguelette sur l’océan des malheurs absurdes. Verdun n’est pas un échec stratégique pour la France mais la perte humaine pour le pays est immense et irréparable. Que de talents, d’intelligences, de génies peut-être perdus que nous ignorerons pour toujours. Songeons que Charles de Gaulle a été blessé deux fois – à Dinant et à Verdun – et que le hasard aurait aussi bien pu le tuer.
Jusqu’au xviiie siècle, la guerre n’était pas une guerre totale, une lutte à mort dans laquelle le pays jouait sa survie mais plutôt un tournoi rituel destiné à arbitrer un différend. Dans des sociétés où la plupart des habitants vivaient en limite de survie alimentaire, on savait que la guerre, en détournant des ressources de l’agriculture, risquait de provoquer des famines. Le monde et la vie étaient trop durs pour prendre le risque de mobiliser longtemps des ressources importantes pour ce jeu imbécile qui consiste à s’entretuer. On ne voulait surtout pas monter aux extrêmes. La guerre était bornée par le bon sens.
Ceci fait un contraste avec l’apogée de la montée aux extrêmes de 1945. Que dit Hitler en avril 1945 ? Le peuple allemand est vaincu, il n’est pas le plus fort. Or seuls les plus forts doivent survivre. L’objet de la guerre est de savoir qui doit survivre ou pas. C’est une guerre à mort. Donc le peuple allemand doit disparaître avec son Führer. Et Hitler donne l’ordre à Albert Speer de détruire les installations industrielles allemandes avant l’arrivée des envahisseurs. Fort heureusement, Speer désobéit, au péril de sa vie. Il argumente sa désobéissance en entrant dans la logique d’Hitler. Non la guerre n’est pas perdue, dit-il en substance, et il sera précieux de récupérer ces installations après la contre-attaque foudroyante et victorieuse que les armées du Reich ne vont pas manquer de mener. Hitler fait semblant de le croire, à moins qu’il ne soit effectivement devenu assez fou pour le croire. Dans sa folie, Hitler ordonne que les populations évacuent les régions envahies par les armées étrangères, se regroupent dans le centre de l’Allemagne pour se battre jusqu’au dernier. Ordre évidemment et heureusement inexécutable.
La montée aux extrêmes est fondée sur l’idée que ce sont ceux qui mobilisent le plus de ressources qui gagnent les guerres. Ce sont donc les États les plus grands, les plus centralisés et les plus belliqueux qui ont dominé la géopolitique. Ce qui n’est pas une excellente nouvelle.
« Polemos est père et roi de tout », écrivait Héraclite. Polemos est une divinité allégorique qui personnifie la guerre.La loi des rapports humains est un éternel combat. Après la chute de Napoléon, Clausewitz constate l’incapacité à contenir l’accroissement réciproque des forces, d’où son idée de montée aux extrêmes qui éclaire les rapports franco-allemands de la défaite de la Prusse en 1806 à l’effondrement de la France en 1940 et de l’Allemagne en 1945. Un commentateur de 1945 aurait pu attribuer à Clausewitz une intuition particulièrement affûtée. Le monde va de plus en plus vite vers les extrêmes. Le stratège prussien entrevoit sans doute un avenir sombre, un « effort vers les ténèbres extérieures » qui devait choquer son rationalisme.
Le philosophe René Girard fait dériver la montée aux extrêmes de sa propre théorie du désir mimétique. Pour René Girard, le désir humain est de nature mimétique. L’homme ne sait pas désirer par lui-même, il désire ce que l’autre désire. Un tiers sert de modèle à mon désir, par son propre désir il m’indique ce que je peux et dois désirer. Mais le sujet désirant et le modèle se trouvent alors en situation de rivalité pour la possession de l’objet. D’où la violence. Violence initiale fondée sur la rivalité pour la possession de l’objet. Mais cette violence initiale est renforcée par une violence seconde ou mimétique : l’autre est jugé violent, ce qui accroît la violence. La violence réciproque s’accompagne d’un accroissement de violence, jusqu’à la destruction de l’humanité appelée apocalypse.
Voilà ce qu’a entrevu Clausewitz avant de mourir en laissant une œuvre inachevée.
Clausewitz contre l’humanisme
Un couple de nonagénaires se présente chez un avocat. « On veut divorcer. » L’avocat un peu surpris leur demande : « Mais enfin pourquoi ? – Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce qu’on ne se supporte plus, pardi ! – Ah oui, répond l’avocat toujours un peu sceptique, vous ne vous supportez plus. Mais depuis quand ? – Depuis quand ? Depuis quand ? Mais depuis soixante-dix ans, nom d’un chien ! – Depuis soixante-dix ans, vous ne vous supportez plus ? » Les deux vieux opinent et confirment, depuis soixante-dix ans, ils ne se supportent plus. « Mais enfin, poursuit l’avocat, c’est absurde, pourquoi n’avez-vous pas songé à divorcer plus tôt ? – Plus tôt, plus tôt, et pourquoi donc plus tôt ? Comme vous y allez ! – Eh bien oui, explose l’avocat, pourquoi pas plus tôt ? Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ? – Mais enfin, répondent les deux vieux un peu choqués, nous attendions que les enfants soient morts. »
Ce constat de la montée aux extrêmes a été validé dans les faits au xxe siècle. Les deux guerres mondiales sont de parfaits archétypes de montée aux extrêmes : guerre totale, mobilisation de tous les moyens des pays, victimes par dizaines de millions, engagement de plusieurs dizaines de pays. On a vraiment de la super production que Clausewitz aurait appréciée. Il aurait sans doute reconnu qu’à côté de cela, l’époque napoléonienne avec un Corse prétentieux dans le rôle titre faisait un peu chichiteuse malgré la légende qui l’accompagne. Aller à Moscou et perdre son armée, ça fait de belles images, mais tuer vingt-huit millions de Russes et perdre une armée à Stalingrad par pur entêtement dans la stupidité donne encore un drame d’une autre ampleur.
Ces événements autorisent a posteriori deux regards possibles sur Clausewitz : un regard positif et un regard négatif.
- Regard positif : Clausewitz a compris le premier la nature de la guerre et la façon dont la technique – la culture – allait s’incarner dans la nature. Cette compréhension avant les autres lui a permis de prédire l’avenir.
- Regard négatif. Avec cette idée de « montée aux extrêmes », Clausewitz a rendu banale une conception monstrueuse des relations internationales. Il a légitimé – en la posant comme naturelle – une vision de la guerre qui n’est pas naturelle du tout, qui n’est jamais qu’une vision parmi d’autres et dont les conséquences sont inhumaines. Clausewitz a biaisé les esprits en dissociant les relations internationales de l’humanisme au moment même où l’humanisme devient la philosophie dominante, en posant comme allant de soi ce qui est monstrueux. À ce titre, il est co-responsable des tragédies historiques qui ont suivi.
On l’aura compris, notre propos est issu du second regard. Notons, pour écarter la thèse positive que Clausewitz reste théorique et ne fait pas de prévision. Il s’occupe de stratégie, pas d’histoire. Il n’est pas de ceux qui – tels Cassandre – annoncent une catastrophe pour nous aider à l’éviter.
En 1914, les Européens ont considéré que la politique la plus normale consistait à envoyer leurs jeunesses respectives s’entretuer, jusqu’au dernier si possible. C’est cette normalité qu’il nous faut interroger. Les décideurs politiques et militaires pendant la Grande Guerre décidaient comme si la façon dont la guerre se déroulait était tout à fait normale et habituelle. Comme si on n’était pas en train d’infliger à l’humanisme une blessure mortelle.
Puis à la fin de la Grande Guerre, on a parlé du suicide de l’Europe. Suicide économique et démographique certes, mais on a commencé à évoquer aussi un suicide moral. L’Europe s’était enfoncée dans une vision de la stratégie – celle de Clausewitz – qui allait à l’encontre de ce qu’elle essayait de construire depuis le xviiie siècle : une société qui soit le déploiement et la matérialisation de l’humanisme. La Grande Guerre ayant attisé et augmenté les haines plutôt que de les réduire, elle a conduit sans délai à la Seconde Guerre mondiale. Cette Seconde Guerre mondiale a ajouté deux nouvelles pratiques à l’anti humanisme : le génocide légal et industriel d’une part, le bombardement massif des populations civiles d’autre part.
Ce n’est pas seulement le nombre invraisemblable de victimes qui a donné à penser qu’il fallait regarder et embrasser le monde autrement, c’est aussi la façon dont se sont décidées les choses. On ne pouvait pas ignorer que les barbares étaient arrivés au pouvoir.
Par subtiles gradations et légères modifications génétiques, ces barbares sont les descendants de Clausewitz.
La continuation de la politique
Mais qu’a-t-il donc écrit de si barbare, ce Clausewitz, officier prussien intelligent, raffiné, bien éduqué ? Cet homme qui, à la pointe de la civilisation de son temps, cherche seulement à comprendre les événements auxquels il a assisté. Clausewitz a vécu une époque riche d’événements étonnants, porteurs d’avenir, dont il cherche à discerner la logique et le sens. Ce qu’il fait avec un talent incontestable. Qu’a-t-il à voir avec les barbares ?
La citation la plus célèbre de Clausewitz dit : « La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens. » Et en effet, selon Clausewitz, il s’agit de la politique des États, rien de plus et rien de moins. Il ne voit pas – bien que cela soit justement sous ses yeux – que l’idée de montée aux extrêmes est contraire à la politique.
La politique est l’art du vivre ensemble, le débat sur des choix collectifs. Que ce soit pour les individus entre eux et pour les nations. La politique sert à sortir de la lutte de tous contre tous. De même entre les nations, la politique sert à sortir de l’état de guerre permanente.
La guerre n’est donc pas un sous-ensemble de la politique mais un moment d’échec de la politique. Moment que l’on espère bref.
Naturellement, Clausewitz sait cela. S’il dit l’inverse, c’est parce qu’il analyse la guerre de l’extérieur, froidement et en théoricien. La guerre s’analyse stratégiquement comme la politique. Telle est sa posture. Si la guerre est une forme d’échec de la politique, Clausewitz nous dit que cet échec advient tôt ou tard et qu’il doit être regardé et pensé avec nos outils d’analyse. En tant qu’inverse de la politique, la guerre est une politique. De même que l’inverse d’une décision est une décision, la décision d’arrêter la politique est une décision politique.
La politique – comme la décision – n’a pas d’inverse. Avant de prendre des décisions, nous sommes pris par la décision, avant de faire de la politique, nous sommes pris par la politique. C’est probablement cela qu’entendait Clausewitz en banalisant la guerre comme une simple respiration de la politique.
Ce que la suite de l’histoire a montré avec un déchaînement d’horreur, c’est que la montée aux extrêmes n’est plus de la politique mais de la barbarie pure. Ce n’est donc plus de la politique dont l’objet est tout de même d’éviter la barbarie.
Dire que la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens est devenu une banalité tant la formule a été répétée, ressassée ad nauseam. Cette banalité peut faire oublier quelques points essentiels :
- Cette formule est nouvelle. Au xviiie siècle, on considérait que la guerre était chose bien différente de la politique. La guerre était plutôt le moment de suspension de la politique.
- Cette formule est révolutionnaire, elle change le regard sur la guerre qui devient une pratique professionnelle banale. On embauche des armées de métier qu’il faut bien occuper.
- Cette formule, couplée à l’idée de montée aux extrêmes des moyens engagés, ne peut conduire qu’à une barbarie massive. En ce sens, les dictateurs qui considèrent comme normal de faire tuer des millions d’hommes pour atteindre leurs buts politiques sont les continuateurs logiques et barbares de la pensée de Clausewitz.
Clausewitz a donc réussi à banaliser la barbarie alors qu’il visait l’inverse. Pendant deux guerres mondiales, des hommes politiques et des militaires ont pensé qu’ils ne faisaient que de la politique en plongeant dans la barbarie la plus sauvage et la plus démesurée. En ce sens, on peut voir dans la pensée de Clausewitz une tragique erreur.
Aujourd’hui, les historiens pensent que la Grande Guerre est un mystère. Le mystère est le suivant : comment des hommes raisonnables ont-ils pu raisonner ainsi, envoyer sans hésiter leurs enfants à la mort ? Cette idée même de mystère indique combien nous sommes éloignés de la pensée de Clausewitz aujourd’hui.
Brûler Clausewitz ? Certes non, mais le connaître pour en définir les limites.